|
|
[ Sports/Kabylie ] [ Photos ] [ Famille ] [ Sports/Algérie ] [ Liens/clips/videos ] [ Histoire/Autres ] [ Poésie/Social ] [ Divers ] [ Musique ] [ Culture ] [ Evenements ]
|
|
|
|
Printemps berbère
17/04/2009 23:54

29 ans après, que reste-t-il de ce mouvement populaire bien ou mal pris en charge par les partis politiques après 1989, année de l’ouverture du pluralisme politique ?
La revendication identitaire amazigh, hier combattue et ses initiateurs mis à l’index, a été parmi les thèmes débattus par les candidats à la dernière élection présidentielle. À chacun de tirer les marrons du feu en faisant dans la surenchère. Le fait et la vérité historique reviennent à son précurseur : l’écrivain Mouloud Mammeri interdit de donner une conférence sur la poésie populaire dans une enceinte qui porte aujourd’hui son nom. C’est dire qu’il est dangereux d’insulter l’avenir car l’histoire finit, dans la plupart des cas, par avoir le dernier mot.
Depuis 1980, le combat a été long, très long. Ses leaders ont connu la prison et les difficiles conditions de détention, mais à chaque étape de ce cheminement, le mouvement avait pris de l’ancrage auprès de la population qui a fini par y faire corps, parce que convaincue de la justesse et de la légitimité de la revendication. D’abord, l’enseignement de tamazight à l’école et ensuite, en 2001, la reconnaissance officielle par l’état de cette langue. La victoire, à chaque étape, a été arrachée, mais au prix d’un lourd sacrifice en vies humaines. Et comme les symboles ne meurent jamais, le Président, lors de son dernier passage à Tizi Ouzou, a promis d’accorder aux victimes le statut de martyrs. Pouvait-il en faire autrement puisqu’ils le sont déjà dans les cœurs et dans l’histoire à écrire ?
29 ans après, que reste-t-il de ce mouvement populaire bien ou mal pris en charge par les partis politiques après 1989, année de l’ouverture du pluralisme politique ? Certains ont continué la lutte qu’ils avaient entamée encore étudiants en lui donnant la force qui lui manquait dans un cadre organisé, d’autres s’en sont servi comme d’un fonds de commerce à chaque échéance électorale. Le mouvement des arouchs, spontané à ses débuts, a fini par sombrer dans des palabres de commissions toujours ouvertes, et sans résultats probants. Le mouvement a 29 ans aujourd’hui, et il faut dire qu’il a pu arracher le primordial : l’enseignement de tamazight à l’école, puis le statut de tamazight comme langue nationale et, dernièrement, l’ouverture d’une chaîne de télévision thématique. Que l’on se souvienne : le sommeil du juste porte toujours ses fruits, surtout quand ce sont ceux du mois d’avril.
Par :Outoudert Abrous
Copyright (c) 1998-2008 Tous droits réservés LIBERTE
| |
|
|
|
|
|
|
|
Jugurtha...Un aguellid berbère contre Rome
08/06/2008 06:47

La figure de Jugurtha rappelle à tout Africain la lutte d'un chef numide contre la pénétration romaine à la fin du IIe siècle avant l'ère chrétienne. Mais qu'est-ce que l'Afrique pour Rome, à cette période ? S'il est assez facile de parler de Rome à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, il est beaucoup plus compliqué, en revanche, de fournir des renseignements sur l'Afrique où pourtant Rome avait eu des visées expansionnistes dès le début de cette guerre de cent ans de l'Antiquité, plus connue sous le nom des « trois Guerres puniques ».
Entre la date de 146 avant Jésus-Christ qui marque la fin de Carthage et les différents épisodes de la guerre dite de Jugurtha, entre 111 et 105 avant Jésus-Christ, s'ouvre une nouvelle phase de l'histoire de l'Afrique où la figure dominante, succédant au célèbre Massinissa, est sans conteste celle de Jugurtha.
Pourtant, et comme pour une grande partie de l'histoire de cette période, les données manquent et si ce n'était l'œuvre de l'historien latin Salluste [1], connue sous le nom de Guerre de Jugurtha, nous n'aurions que très peu de choses à en dire. Les sources de notre connaissance du personnage sont en effet très limitées. L'œuvre maîtresse dans laquelle tous les historiens puisent des renseignements sur Jugurtha reste donc le Bellum Jugurthinum. A côté de cet ouvrage ne subsistent que quelques fragments, notamment dans Diodore de Sicile ou dans l'Histoire romaine de Tite-Live, dans laquelle les événements ayant trait à la guerre de Jugurtha se trouvent réduits à de simples et brèves mentions.
Salluste a écrit la Guerre de Jugurtha vers les années 42-40 avant Jésus Christ, alors qu'il était âgé de quarante-six ans environ et qu'il s'était retiré de la vie politique après son dernier poste de proconsul dans la toute dernière province que Rome venait d'annexer : l'Africa Nova [2].
Les limites du nouveau territoire, dont la capitale était soit Zama, soit Cirta Nova Sicca (Le Kef), demeuraient imprécises au sud. Du côté est, la limite suivait la frontière de l'Africa Vetus, le fossé de Scipion ou Fossa Regia, depuis l'Oued-el-Kebir, près de Tabarka, jusqu'à l'entrée de la petite Syrte, à côté de la ville de Thaenae (Henchir Thyna près de Sfax).
Du côté occidental la nouvelle province était bordée par un territoire donné à Sittius, un lieutenant de César. Il semble que la limite entre l'Africa Nova et le territoire de Sittius partait d'un point situé sur la côte entre Hippo Regius (Annaba) et Rusicade (Skikda), passait à l'ouest de Calama (Guelma) et se poursuivait vers le sud-ouest.
Salluste a donc eu à exercer une responsabilité sur ce territoire pendant plus d'un an et demi. Lorsqu'il en parle, à propos de la guerre de Jugurtha, on peut supposer qu'il a une certaine familiarité avec le pays, même si ça et là on note quelques erreurs. Cependant, un certain nombre de questions se posent à propos du sujet qu'il a choisi de traiter alors que près de soixante-dix ans s'étaient écoulés depuis la fin de la guerre et qu'il n'a pu, par conséquent, utiliser des témoignages oraux. L'auteur a-t-il étudié consciencieusement son sujet, a-t-il su et voulu dire la vérité ? Pour répondre, il faudrait savoir où Salluste a puisé ses sources et dans quel esprit il a mis en oeuvre les renseignements qu'il avait recueillis.
En ce qui concerne les sources utilisées, Salluste rapporte lui-même qu'il s'était fait traduire les livres du roi numide Hiempsal écrits en punique [3]. Pour les sources grecques ou latines de Salluste, nous n'avons aucune indication. On suppose seulement qu'il a pu s'inspirer de certains annalistes, tels Sempronius Asellio, d'historiens latins, comme Cornelius Sisenna, ou encore d'historiens grecs, tel le célèbre Posidonius d'Apamée.
Le problème, on le voit, est assez complexe quand il s'agit d'étudier un personnage aussi important à son époque que fut Jugurtha, avec pratiquement une seule et unique source. Il est alors permis de se demander quel degré de confiance l'on peut accorder au récit de Salluste sur les événements au cours desquels s'est illustré Jugurtha.
Jugurtha, petit-fils
de Massinissa
Salluste entreprend son récit, comme dans une pièce dramatique, en nous présentant les personnages et les protagonistes du drame qui va se jouer en grande partie sur la terre africaine. Il met l'accent, dès le départ, sur le problème fondamental qui est, à ses yeux, la trahison du parti de la noblesse à Rome, qui n'a que « mépris pour la vertu et la chose publique ». Avant d'en arriver au personnage qui s'opposera à Rome, entre 118 et 105 avant Jésus-Christ, Salluste fait un bref rappel de la situation antérieure :
«J'entreprends d'écrire l'histoire de la guerre que le peuple romain a faite à Jugurtha, roi des Numides. D'abord, parce qu'elle a été cruelle, sanglante, marquée par bien des vicissitudes. Ensuite parce qu'elle est devenue le point de départ de la lutte contre la tyrannie des nobles, lutte qui a bouleversé toutes choses divines et humaines et mis un tel délire dans les esprits que seuls la guerre et le ravage de toute l'Italie ont pu mettre fin à ces fureurs civiles. Mais avant d'en aborder le récit, je résumerai en quelques mots les faits antérieurs pour rendre cette histoire plus claire.
Lors de la seconde Guerre punique, dans laquelle le chef des Carthaginois, Hannibal, avait porté à l'Italie le plus rude des coups qu'elle avait eu à subir depuis l'établissement de la puissance romaine, Massinissa, roi des Numides, admis à notre alliance par Publius Scipion que ses exploits avaient fait surnommer l'Africain, s'était signalé par des faits d'armes multiples et brillants. Le peuple romain l'en récompensa après la défaite des Carthaginois et la capture de Syphax, souverain d'un vaste et puissant empire africain, en lui faisant don de toutes les villes et de toutes les terres qu'il avait conquises. Aussi, Massinissa nous garda-t-il toujours une amitié fidèle et indéfectible. Mais son règne finit avec sa vie. Son fils Micipsa fut seul à lui succéder, la maladie ayant emporté ses frères Mastanabal et Gulussa. Micipsa fut père d'Adherbal et de Hiempsal. Il recueillit dans son palais le fils de son frère Mastanabal, Jugurtha, laissé par Massinissa dans une condition inférieure parce qu'il était né d'une concubine, et lui donna la même éducation qu'à ses propres enfants.» En aidant à la reconstitution du grand royaume de Numidie (fig. 2), Scipion l'Africain désirait non seulement récompenser Massinissa pour l'aide qu'il avait apportée à Rome dans sa lutte contre Carthage, mais encore l'entraîner dans une situation de vassalité qu'il lui aurait été difficile de secouer. Massinissa termine sa vie [4] par une sorte d'aveu d'impuissance puisqu'en 148 il fait appeler, pour régler sa succession, le petit-fils adoptif de Scipion l'Africain qui conduit le siège devant Carthage.
Les attributions royales furent partagées entre ses trois fils légitimes : Micipsa reçut l'administration du royaume, Gulussa l'armée, et Mastanabal la justice. Notons à ce sujet qu'une stèle punique datant de 148, découverte à Constantine, dans le quartier d'EI-Hofra, mentionne les trois rois sans différence dans les prérogatives.
Gulussa et Mastanabal moururent peu de temps après leur père et Micipsa resta seul roi (en libyque, on disait aguellid). Son long règne (148-118) ne fut pas marqué par d'importants événements. À l'égard de Rome, il se conduisit en fidèle allié, mettant à sa disposition une aide humaine et matérielle chaque fois qu'elle était demandée, notamment en Espagne contre Viriathe et les Lusitaniens et durant le siège de Numance par Scipion Émilien en 134. Il ne posait donc aucun problème aux Romains qui s'étaient installés, après la destruction de Carthage en 146, sur le territoire de l'ancienne puissance voisine de la Numidie (voir carte).
Il semble même avoir facilité l'implantation de commerçants, mais aussi de trafiquants romains à Cirta (Constantine) et dans la Numidie. À la fin de sa vie, et comme lors de la succession de Massinissa, probablement sous l'influence romaine, il a dû penser à celui qui prendrait la relève et assumerait le pouvoir, tout en restant en bons termes avec les Romains qui administraient la province Africa .
Micipsa avait deux fils légitimes, Adherbal et Hiempsal, à qui il aurait souhaité réserver la succession tout entière, écartant ainsi les autres prétendants de la famille de Massinissa. Mais il dut prendre une autre décision.
Son frère Mastanabal avait eu également deux enfants, Gauda, né d'une épouse légitime, et Jugurtha, issu d'une concubine et normalement «non qualifié pour accéder au trône». Gauda ne semble avoir été retenu qu'en seconde position pour la succession car «c'était, selon Saluste, un homme rongé de maladies qui avaient quelque peu diminué son intelligence » [6]. Il n'en régna pas moins à partir de 105 avant Jésus-Christ.
Salluste à tenté d'expliquer alors les raisons qui amenèrent Micipsa à adopter Jugurtha. Il lui fait dire, en effet, sur son lit de mort : «Tu n'étais qu'un petit enfant, Jugurtha ; ton père était mort, et t'avait laissé sans avenir et sans ressource. Alors moi, je t'ai reçu dans la famille royale ; j'ai fait cela dans la pensée que ces bienfaits me voudraient de ta part une affection égale à celle qu'auraient pour moi mes propres enfants, si je venais à en avoir».
Cette légitimation a dû intervenir alors que Jugurtha n'avait qu'une dizaine d'années, vers 143 avant Jésus-Christ, avant même que naissent Adherbal et Hiempsal.
Par quelques phrases suggestives, Salluste nous a dépeint la jeunesse de Jugurtha, et sa rapide ascension au milieu de son entourage. Ses qualités physiques et sa personnalité rappellent celles de son grand-père Massinissa.
«Des sa première jeunesse, Jugurtha s'était fait remarquer par sa vigueur, par sa belle prestance et, surtout, par son intelligence. Il ne se laissait pas corrompre par le luxe et par l'oisiveté, mais comme c'est l'usage dans son pays, montait à cheval, lançait le javelot, disputait le prix de la course aux garçons de son âge et, tout en se montrant supérieur à tous, se faisait aimer de tous. Il consacrait, en outre, une grande partie de son temps à la chasse et était toujours le premier, ou parmi les premiers, à s'attaquer à des lions et autres bêtes féroces. Nul n'agissait plus que lui et nul ne parlait moins de ses propres actions.».
Il devint populaire parmi les tribus numides ce qui ne manqua pas d'inquiéter le vieux roi Micipsa, enfin père de deux garçons. «Mais n'osant pas le faire périr, par crainte d'une révolte de ses sujets, il l'aurait envoyé devant Numance, avec l'espoir qu'il s'y ferait tuer, victime de sa bravoure.» Jugurtha a donc quitté la capitale, Cirta, au cours de l'année 134 et s'est rendu en Espagne, à la tête de cavaliers numides, pour aider les troupes romaines qui assiégeaient Numance [9]. Il se fit remarquer aussi bien par les Romains que par les troupes adverses. Salluste lui-même reconnaît «qu'il était à la fois intrépide dans les combats et sage dans le conseil, qualités qui vont rarement de pair... Il en résulta que Scipion prit l'habitude de charger Jugurtha de toutes les entreprises dangereuses»
(A suivre)
Mounir Bouchenaki
Conservateur en chef
au service des Antiquités,
Tipasa (Algérie)
Source : http://www.lanouvellerepublique.com/actualite/lire.php?ida=64916&idc=29&date_insert=20080607
| |
|
|
|
|
|
|
|
Drapeau berbère de Tamazgha (Afrique du Nord)
24/04/2008 02:36

Création infographie Kabyle.com - Droits réservés
Provenance:
Le symbole aza, aussi lettre yaz [z] de l’alphabet berbère est depuis la préhistoire le symbole des Imazighen.
C’est à Tenerife (aux Canaries) en 1998, que le Congrès Mondial Amazigh présente le premier drapeau berbère.
On prête au berbériste Mohand Aarav Bessaoud de l'Académie Berbère la création du premier drapeau de l'Afrique du Nord jaune et bleu aujourd'hui attribué à la Kabylie ainsi que la pérennité du drapeau actuel de la Tamazgha.
Les couleurs:
Du Nord au Sud (de haut en bas)
Le bleu : la mer Méditerranée et océan Atlantique
Le vert : la nature et les montagnes verdoyantes
Le jaune : le sable du désert du Sahara
Où trouver le drapeau berbère ?
Sur la boutique de Kabyle.com
www.boutique-berbere.com
Marché Porte de Clignancourt - Paris
Associations kabyles et berbères
Télécharger le logo au format vectoriel imprimerie:
(le premier drapeau grand format numérique et vectoriel diffusé sur internet a été réalisé en 2001 par Kabyle.com)
http://www.kabyle.com/forums/showthread.php?t=22960&highlight=drapeau+vectoriel
http://www.kabyle.com/spip/spip.php?article2047
Source : http://www.kabyle.com/drapeau-berbere-de-tamazgha-afrique-du-nord-1115-220308
|
Commentaire de labelleeve (05/06/2008 02:24) :
Comment vas-tu Areski, mon ami Berbère?J'espère que ça roule pour toi.
Je vois que tu as mis le drapeau avec l'Iamzériane: très joli symbole.
Mes enfants et petits enfants en ont une en pendentif, ils en sont très
fiers. Mes 2 fils, la leur vient d'Agérie, elles sont en argent, celle
de ma fille, je l'ai faite faire en France et mes deux-petits fils
l'ont eue en cadeau par leur grand-père qui leur a ramené
d'Algérie aussi, mais il a pris de l'or français. Ton blog me
rappellent de très bons souvenirs: les fêtes, les repas ...Super. Je te
souhaite une bonne journée et te fais des gros gros bisouxxx. A bientôt.
http://labelleeve.vip-blog.com/
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
La jeunesse d'Albert
20/04/2008 07:33
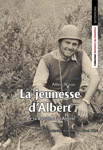
Bonjour ,
Albert, un Breton du terroir, un fils de paysan, né en 1934 (73 ans), nous
raconte sa jeunesse, jusqu'à l'âge de 23 ans où il acheva son service
militaire obligatoire en Petite Kabylie. En 1956 et 1957, cet homme bon et
sensible participa contre son gré à la guerre dite de « pacification et de
maintien de l'ordre », un épisode atroce qui cache bien son nom. Il est
revenu dans sa belle province, la Bretagne, traumatisé par l'expérience
vécue en Algérie, comme la plupart de ses camarades de régiment.
Il témoigne, il nous dit ce qu'il a vécu : la dure vie dans le bled, les
marches forcées sur les djebels, les ratissages du terrain, les contrôles
des villages : Béni-Ourtilane, El-Maïn, Bouhamza, Freha, Djahnit, Ouled Sidi
Idir, les combats, les traquenards et les atrocités perpétrées par l'un et
l'autre camp. Mais aussi, cet homme pacifique, soumis
aux ordres de ses supérieurs et contraint d'obéir, réprouvait dès le départ
une guerre qu'il jugeait perdue d'avance - on ne lutte pas contre un peuple
qui combat pour la liberté et aspire se libérer du joug de la
colonisation -, et il ne cache pas sa sympathie pour les population kabyles
victimes de la guerre. A ces « pauvres parmi les pauvres », les soldats
français, qui avaient souvent faim et soif, prenaient encore leurs maigres
réserves de nourriture, et augmentaient leur dénuement.
Pendant qu'il « crapahutait » dans les djebels, et qu'il assistait, contre
son gré, à des scènes pénibles, Albert fit la promesse de témoigner.
Quarante huit années après son retour en France, il témoigne, mais, en son
âme et conscience, il ressent toujours le poids énorme de la barbarie.
Combien de jeunes du contingent, victimes de la guerre d'Algérie, ont osé
témoigner ? Presque pas ! Le mal reste tapi au fond de leurs mémoires, plus
insidieux qu'un serpent. Certains se sont suicidés, la plupart se sont tus,
renfermant à tout jamais leurs terribles souvenirs ; ils en souffriront
jusqu'à la mort.
A partir du récit d'Albert, j'ai écrit un livre de témoignages Il s'intitule
: « La Jeunesse d'Albert ».
Ceux qui ont vu le film « Ennemi intime », apprécieront.
Ce livre vient d'être édité chez LIV'EDITIONS, au Faouët. (56320) BP 15.
Site du livre : http://60gp.ovh.net/~livediti/index.php?b=livre_fiche&id=247&PHPSESSID=7ce816ce120bdae70eb81102f5d7a6a6
Cordialement
Marcel Gozzi
http://www.amazon.fr/gp/search/171-9485720-0715458?search-alias=stripbooks&field-author=Gozzi%2C%20Marcel
http://www.amazon.fr/Souvenirs-Chien-Chien-Goz-Marzic/dp/2748171640/sr=11-1/qid=1167743870/ref=sr_11_1/402-6458333-9224944
http://www.manuscrit.com/catalogue/textes/fiche_texte.asp?idOuvrage=7579
|
Commentaire de Soleildevie (10/09/2008 21:58) :
Je te souhaite
des sourires quand la tristesse
t' envahit
du réconfort quand tu crois
ne pas avoir le moral
de la confiance quand tu as
des doutes
beaucoup d'amour
à donner et à recevoir
je te souhaite
une excellente semaine
 MARTINE
TRES EMOUVANT A LIRE
MARTINE
TRES EMOUVANT A LIRE
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
KRIM BELKACEM : Le nif et le baroud
22/03/2008 02:50

Il a négocié sans concession l’Indépendance de l’Algérie, qui a mis fin au mythe de l’Algérie française.
20 mai 1961, il est près de 11h du matin. Le soleil s’est déjà levé sur la ville d’Evian, en Suisse.
L’hôtel du Parc reçoit les deux délégations algérienne et française. Il s’agit de mettre fin à une colonisation féroce qui a duré plus de 130 ans. Les négociations peuvent commencer, mais sans témoin. Que veut-on cacher au monde? Cette plaie béante qui s’appelle Algérie, solidement accrochée et tatouée au fronton de la patrie des droits de l’homme? Ou bien, tout simplement, la détermination farouche d’indépendance d’une poignée de jeunes Algériens emmenés par celui que l’on surnomma «le Lion des djebels»? A ce moment-là, personne ne savait que le sort du mythe de l’Algérie française était désormais définitivement scellé.
L’homme qui préside la délégation algérienne, est entouré de compagnons de lutte, jeunes et brillants. Krim Belkacem et son équipe, composée de Mohamed Seddik Benyahia, Réda Malek, Tayeb Boulahrouf, Ahmed Boumendjel, Saâd Dahlab et Ahmed Francis, ne cèderont pas d’un pouce. Krim Belkacem annonce la couleur, il sera sans concession. Il va en découdre avec l’ennemi, mais en terrain neutre.
«Le problème pour lequel on est ici réunis est celui de la décolonisation totale de l’Algérie, de la disparition d’un système périmé et de l’accession de notre peuple à l’indépendance.» Le message est clair. Le coup de grâce est annoncé. Krim Belkacem et ses compagnons porteront l’estocade. Le coup de grâce sera donné le 18 mars 1962.
L’arrêt des combats est ordonné le 19 mars 1962. L’empire colonial français a mis un genou à terre. Il sera définitivement terrassé le 5 juillet 1962.
Après la proclamation de l’indépendance en Algérie, Krim Belkacem a mené les négociations qui ont abouti aux Accords d’Evian du début jusqu’à la fin. Elles auront duré dix mois presque, jour pour jour, marquant la patience d’un homme qui aura tenu le maquis près de dix ans avant le déclenchement de la guerre de Libération nationale, le 1er Novembre 1954.
Il aura incarné à lui seul toutes les fièvres et les soubresauts qui auront jalonné le Mouvement de libération nationale, et particulièrement de l’une de ses étapes, la fin du PPA-MTLD et la chute de son chef historique, Messali Hadj. Héros de la guerre de Libération nationale, Krim Belkacem, «Si Rabah», n’en constitue pas moins un des «mythes» de l’un des plus fabuleux combats menés pour la liberté et contre le colonialisme français.
Il s’est dressé en rempart contre l’humiliation, la spoliation et les crimes commis par l’armée coloniale française. Dans cette fierté et cette dignité qui caractérisent ces hommes des montagnes, ces Amazighs, ces hommes libres. Guerrier infatigable, il était toujours prêt à livrer bataille jusqu’à la dernière goutte de son sang.
Il était à l’image de ce peuple fier: un descendant direct de Jugurtha. Né à Draâ El Mizan un 14 décembre 1922, il fréquenta l’école Sarrouy à Alger où il décrocha son certificat d’études primaires. Une performance pour un musulman, à l’époque. Krim Belkacem serait cependant cet homme qui a trempé dans la Révolution dans le ventre de sa mère. Il est animé très tôt d’idées révolutionnaires.
Dès 1945, il adhère au Parti du peuple algérien, le PPA. En 1947, il est convaincu que seule la révolution, la lutte armée peut mener à la liberté. Dès lors, il prendra le maquis où il organise et forme des groupes militaires. Il sera en avance de sept années sur le 1er Novembre 1954. Un chiffre prémonitoire, puisque la guerre de Libération durera sept ans. Il dominera le FLN-ALN en 1958-1959 en tant que ministre des Forces armées.
Il sera à la tête du ministère des Affaires étrangères et de celui de l’Intérieur au sein du Gpra, le Gouvernement provisoire de la République algérienne, entre 1960 et 1961. Paradoxalement, le rôle prépondérant qu’il joue à l’époque déclinera au moment même où il entamera les négociations d’Evian. Il sera retrouvé assassiné au mois d’octobre 1970 dans une chambre d’hôtel à Francfort.
Sa vie, à elle seule, est un foisonnement d’espoirs et de désillusions qui ont mené l’Algérie à la liberté. Il aura donné au centuple, à une patrie martyrisée, pour qu’elle retrouve sa dignité. Elle ne le lui a rendu que mesquinement.
Mohamed TOUATI
Source : http://www.lexpressiondz.com/article/2/2008-03-20/50956.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
Jeunesse Sportive de Kabylie (J.S.K)...
16/02/2008 14:48

JSKabylie
- Champion d'Algérie (13) :
- Champion : 1973, 1974, 1977, 1980, 1982, 1983, 1985, 1986, 1989, 1990, 1995, 2004, 2006
- Vice-Champion : 1978, 1979, 1981, 1988, 1994, 1999, 2002, 2005, 2007
Source : http://mohamedchelhab.unblog.fr/jskabylie/
|
Commentaire de Ania (28/02/2008 23:43) :
 Bonne continuation ! papa!
Bonne continuation ! papa!
ania_aoa@yahoo.ca |
|
Commentaire de labelleeve (04/05/2008 18:57) :
Beau blog, riche en couleurs. J'ai été "mariée" à un "grand kabyle"
pendant 17 ans et connait la culture berbère ... Ma fille en est très
fière. Tu es de quel coin de la Kabylie? Mes enfants ont leurs
attaches,comme leur père, aux frontières du Djudjura: région magnifique. Je
n'y suis jamais allée.. mais je vois les étoiles dans les yeux des
Kabyles lorsqu'ils reviennent de là-bas. Le seul chanteur que
j'aime est Idir et ce, depuis le début. Bonne continuation.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Yennayer ou le souverain des mois.
12/01/2008 04:14
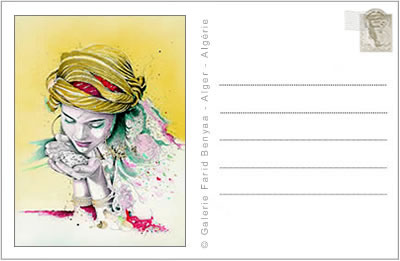
"Avertissement : je ne parlerai pas ici de « considérations extérieures que d’aucuns spécialistes ont développées ici et là à propos de yennayer en partant d’un certain dieu Janus ». Je ne parle ici que de simples choses et faits : « Yennayer de la mère kabyle » en révélant « le visage interne de Yennayer » (udem n Yennayer ) tel que les mères et les grand-mères kabyles se le représentaient et le fêtaient autrefois. Ce fut l’une des manifestations les plus importantes de la cité kabyle." Youcef Allioui
Yennayer est un mois composé qui signifie « premier mois » (yen/ayer). Le premier jour de yennayer correspond aussi aux « premières portes de l’année » (tiggura timenza useggwas), par opposition aux « portes de l’année de l’automne » (tiggura useggwas iweooiben). Yennayer le dit bien aux autres mois qu’il surprit en pleines médisances à son sujet : - « C’est moi qui ouvre les portes de l’année « (d nekk i-gpellin tiggura useggwas). Le dicton dit : « Le roi des mois, c’est yennayer » (agellid n wagguren d yennayer). « Un jour Yennayer surprit les autres mois en train de dire du mal de lui : « Janvier le bruyant poussiéreux, c’est depuis toujours qu’il est comme ça ! » (yennayer à bu-lêrka, ansi yekka ttebâit takka si zzman n jeddi-s akka !) Il leur rétorqua : « Si je la laisse tomber, la relève qui veut ! Si je la relève, la rabaisse qui veut ! » (ma sres$-as wa’b$a yrefd-ip ! ma refde$-p wa’b$a ysers-ip ! ».
On connaît le mythe de la vieille aux moult versions qui, voyant Yennayer s’en aller au bout de son trentième jour, osa le défier en lui disant qu’il était fort seulement en paroles ! « Oncle Yennayer, quelle insignifiance tu traînes derrière toi ! Tu es parti sans avoir rien accompli ! » (Gezggeî a Eemmi Yennayer ! Tôuêev ur texdimev kra !) Mal lui en prit à la vieille, Yennayer la tua elle et sa chèvre dans la journée qu’il avait empruntée à février (Fuôar). Dès qu’il entendit les moqueries de la vieille, il s’en alla voir Fuôar et lui dit : « Je t’en prie oncle Fuôar, prête-moi une seule journée qui restera dans les mémoires : je rendrai gorge à la vieille insolente ! » (Pxil-ek a Eemmi Fuôar, ôevl-iyi yiwen si wussan n nnbaô ; a d-rre$ ppaô di tem$art m-lemôaô !)
Depuis, la dernière journée de Yennayer s’appelle « l’emprunt » (ameôvil). La mythologie nous a également gratifié de « poèmes de yennayer » (isefra n yennayer) et de « chants de Yennayer » (ccna n Yennayer). C’est dire toute l’importance que ce mois de Yennayer revêt aux yeux des Kabyles.
Il est d’usage que nous commencions par le commencement, c’est-à-dire par la fête du « premier de yennayer » (amenzu n yennayer), du 12 au 14 janvier du calendrier grégorien selon les années. Selon les anciens, cette date pouvait varier d’un district à un autre de la Kabylie (Tamawaya), voire d’une région à une autre de la Berbérie (Tamazgha).
Cette fête est appelée la « fête de fin d’année » (tame*ôa n yixf useggwas). A l’origine, la fête durait 7 jours. La première journée était chômée. Quiconque enfreignait l’interdit risquait la stérilité. L’immolation du mouton ou du bélier était un sacrifice rituel offert la Terre - mère nourricière - pour obtenir d’elle une année agricole féconde, fertile, tranquille et prospère. Le dicton dit « Yennayer fait la bonne récolte » (Yennayer d ûûaba). Sentiment profond car, selon mon grand-père, l’année agricole - marquée par un calendrier rigoureux - possède un cycle biologique semblable à celui de l’Arbre, de l’Animal, de l’Oiseau et de l’Homme.
Yennayer était l’une des plus grandes fêtes berbères. Ce premier jour de l’an berbère correspond à ce qui est appelé dans le calendrier berbère solaire le « premier jour des froids blancs » (yiwen g-semmaven imellalen). Ce jour-là correspond également, à peu de choses près, à ce qui est permis d’appeler le « jour de la femme » ou, plus exactement, « le jour de l’Assemblée des femmes » (Ass n Wegraw n tlawin). Une journée bien lointaine où les femmes fêtaient les grands froids de janvier. Nous avons vu que la mythologie kabyle attribue bon nombre de défauts, voire de tares et de catastrophes à notre vieille grand-mère. On lui doit notamment l’immobilité et le mutisme des choses de ce monde. Mais, on lui doit donc aussi le courroux de Yennayer, dont nous sommes en train de parler et dont les femmes kabyles fêtent si bien encore la venue . Mais il est très rare que les petits enfants kabyles, qui ont connu leur grand-mère, trouvent celle-ci mauvaise et acariâtre. On ne peut pas dire d’une vieille femme kabyle qui, pendant les longues soirées d’hiver, captive par sa parole une nombreuse assistance qu’elle n’est pas écoutée ou « qu’elle n’est pas valorisée par sa sagesse », comme d’aucuns l’ont écrit ici et là. Le dicton est clair : « Une maison sans vieille est pareille à une figuerie sans caprifiguier, sans figuier mâle » (axxam mebla tam*aôt am urti mebla tadekkwaôt). Yennayer avait dit aux Anciens Kabyles : « De mon début jusqu’à ma fin, je vous ferai voir de toutes les couleurs, mais, comme vous êtes parmi les peuples premiers, je vous apporterai bonheur et bonnes récoltes ! » (seg-semmaven a l*ezla a-wen seôwu$ imeô$an ; d-acu kan, mi tellan seg’Mezwura, awen-d awi$ lahcaca, a-wen-d rnu$ l$ella !).
Selon ma grand-mère Ferroudja, ce fut une jeune fille sagace qui avait promis d’offrir à Yennayer des crêpes dès le matin de son premier jour et un bon souper pour le soir s’il se montrait plus conciliant avec les pauvres montagnards ! Yennayer lui répondit : « J’accepte avec une offrande choisie, les ustensiles pleins de nourritures, les crêpes et le couscous sans oublier la part de l’absent » (pmadi* s-usfel meqqwren, p-paççaôt l_leêwal, p-pe$ôifin d seksu, d umudd g_gwin inagen).
Depuis, on immole une bête comme offrande dont la viande garnit le couscous du souper de yennayer (imensi n yennayer). On prépare les crêpes (ti$rifin) et beaucoup d’autres gâteaux pour le petit déjeuner. Au retour de la fontaine, les femmes déposaient dans la cour de l’Assemblée les gâteaux qu’elles avaient préparés la veille et le matin. Quant au repas du midi, il est composé de gros couscous (berkukes) dont les graines se gonflent au contact du bouillon comme l’on voudrait que le grain enfoui dans la terre - semé - germe et procure une bonne récolte (ûûaba). Les ustensiles devaient être pleins de victuailles : rite d’abondance. Et comme l’exige Yennayer, on mettait un couvert pour chaque membre de la famille absent. On évite les produits épicés et amers et on prépare des mets sucrés comme les crêpes.
Juste avant le souper, le repas qu’ils n’avaient pas pris, était mis à la disposition des pauvres : un plat était porté à l’assemblée. On ira le reprendre tard dans la nuit. Les absents sont aussi souvent des absentes : les filles mariées auxquelles on met toujours de côté la part de viande, de gâteaux et de friandises qui leur reviennent. Tout le monde devait manger à satiété, y compris les vagabonds de passage qui étaient toujours traités avec beaucoup d’égard, mais surtout ce jour-là. Le soir, juste avant le souper, la mère donnait à ses enfants des graines de céréales qu’ils devaient tenir dans la main le temps d’une prière sur la genèse selon la mythologie kabyle : « Il y eut un jour dans l’univers, le Souverain Suprême transforma les ténèbres en lumière ; il sema les étoiles dans le ciel ; Il enleva tout ce qui était néfaste et lava la boue à grand eau !... » (Yella yiwen wass di ddunnit yekker Ugellid Ameqqwran ; îlam yerra-t p-pisrit, deg’genwan izreƒÕ itran ; yekkes kra yella dirit, alluv yurad s waman. Aluv yurad s waman a Bab Igenwan !...) Chacun doit veiller à soigner sa conduite : s’abstenir de prononcer des mots qui fâchent et d’avoir de mauvaises pensées qui offenseraient le Génie-Gardien de la maison. Chacun doit demander pardon à chacun. Comme la fête de Yennayer durait 7 jours, on attendait la journée où la neige « liait » la fédération kabyle (Tamawya) : quand les montagnes des At Wadda (Archs du Djudjura occidental) et des At Oufella (Archs du Djurdjura oriental, vallée de la Soummam, les montagnes des Portes, des Babors et du Guergour) étaient liées par la neige : on sacrifiait le mouton.
La fête de la rencontre des neiges ou le sacrifice de Yennayer
Dans la vallée de la Soummam avait lieu dans les mois de décembre et Yennayer la fête dite « de la rencontre des neiges » (tamyagert g_gwedfel). Quand la neige de l’Akfadou et du Djurdjura rencontre celle de l’Achtoub et de Takintoucht - montagnes des Babors non loin de Tizi Wouchène -, on sacrifie un mouton. Comme l’avait dit Yennayer, la neige est un signe annonciateur d’une très grande et bonne récolte (ûûaba d l*ella). Nous disons alors « elle l’a réunie » (tsemyagr-ip) : c’est-à-dire que la neige a réuni les deux côtés de la Kabylie « sous son burnous blanc ». Autrefois, pendant Yennayer, les Kabyles allumaient de grands feux de joie pour signifier leur bonheur les uns aux autres. La mère kabyle parcourait avec une lampe tous les coins de la maison pour souhaiter le bonheur à tous les membres de la famille y compris les oiseaux et les animaux domestiques . Il était d’usage qu’elle commence par les parents. Elle tendait la lampe dans la direction de chaque Etre en formulant des souhaits de joie : « Soyez heureux mon père et ma mère ! Soyez heureux mon mari ! Soyez heureux mes enfants ! Soyez heureux anges gardiens de la maison ! Soyez heureux bœufs ! etc. (Ferêewt a baba d yemma ! Ferê ay argaz-iw ! Ferêewt a yarraw-iw ! Ferêewt a y iƒÕessasen g-wexxam ! Ferêewt ay izgaren !) Les enfants se roulaient nus dans la neige pour devenir fort et ne pas craindre le froid ! Ils croquaient l’eau de la neige de Yennayer ! Ils faisaient des batailles rangées à coups de boules de neige. Les grands roulaient un amas de neige jusqu’à ce qu’il devienne aussi grand qu’un grand rocher ; alors ils en faisaientt souvent non pas un grand bonhomme de neige ; lequel, en kabyle, s’appelle « l’ânesse » (ta$yult). Ils installaient « l’ânesse » en bas des villages, sur le plateau réservé au jeu (agwni) avant de la décorer pour l’offrir aussi belle que possible à Yennayer.
Dans toutes les cours intérieures des maisons, les plus petits construisaient des bonhommes de neige à leur taille ((ta$yult tamecîuêt). Un jeu consistait aussi à fabriquer une presse à huile dans la neige. Il y avait des périodes où la neige tombait plusieurs jours de suite. Quand, le matin, les gens ouvraient leurs portes, ils tombaient souvent nez à nez avec un mur blanc de neige du sol au toit de la maison. La couche de neige atteignait parfois plusieurs mètres de hauteur. Les hommes du village devaient sortir et, armés de pelles, ils dégageaient les ruelles du village. C’était une entraide collective obligatoire qui consistait à chasser la neige. Elle porte le nom de « cassure de neige » (taruéi usalu ). Asalu est la couche de neige qui ne permet pas aux pieds d’atteindre la terre ferme. Dans une comptine fort ancienne, les enfants chantaient Yennayer qui provoquait Asalu :
Les portes de l’année sont ouvertes Nous les voyons de l’Akfadou Yennayer prend garde que les mottes de neige ne deviennent de l’eau Garde-les biens pour qu’elles s’amoncellent bien haut Nous, nous sommes en train de « casser l’asalu » !
Tiggura igenwan llint Nwala-tent seg’wkeffadu Yennayer êader ak fsint Eass fell-asen ad alint Nekwni nepôué asalu !
A chaque chute de neige, une fois les ruelles dégagées, les enfants parcouraient le village en chantant : « Dieu, donne des flocons de neige, nous mangerons et resterons à ne rien faire, nous donnerons de la paille aux boeufs ! » (A Öebbi fk-ed ameççim, a-neçç a-neqqim, a-nefk i yezgaren alim !). Comme la neige ne leur suffisait pas, ils allaient jusqu’à la rivière qui gelait. Là ils faisaient du « patin sur glace » et de l’escalade le long des conduits des moulins à eau pour cueillir les figurines qui se formaient dans la glace. Ce sont des jours qu’il est difficile d’oublier. Le Djurdjura et l’Akfadou ainsi que l’Achtoub et les autres montagnes kabyles (Tiggura, Ababur, Aguergour) revêtaient leur manteau blanc. Quand Les mères kabyles voulaient chauffer de l’eau, elles remplissaient de neige propre un ustensile avant de le mettre sur le feu.
Les anciens appelaient la neige « la salive du Maître des Cieux » (imetman n Bab Igenwan). Dans notre mythologie, le Souverain Suprême a créé la neige pour permettre au monde de se régénérer, d’avoir une longue vie. L’eau de la neige en s’infiltrant dans la terre « régénère les tissus, les os de celle-ci ». Le jour où il ne neigera plus, où il n’y aura plus de neige, la terre sèchera comme un vieillard. Ses os craqueront et elle mourra. Quand la neige tombe, c’est le Maître des Cieux qui souffle d’un air frais sur la terre ».
Enfin, le soir du souper, les femmes parlaient avec verve et émotion de leur journée. Toutes les portes restaient grandes ouvertes, car ce jour-là était aussi le jour du carnaval, appelé « le vieux sage au tesson » (am$ar uceqquf ). Les gens restaient dehors afin d’accueillir les enfants qui, masqués, parcouraient le village en chantant le premier jour de l’année.
Ô premier jour de l’année, ô portes des cieux ! La neige arrive à la taille, mais elle deviendra de l’eau Ô maison, ô Génie Gardien, nous nous souvenons de ce jour Les ventres sont pleins et les têtes sont joyeuses...
Ay ixf useggwas p-piggura igenwan Adfel ar wammas, ad yefsi d aman Ay axxam d u*essas, necfa f yiwen wass I*ebbav ôwan, iqqweôôay zhan...
Chaque maîtresse de maison leur remettait des oeufs et des gâteaux, en disant ou en chantant : La fin de l’année, c’est le premier jour de l’année Nous nous en souviendrons, nous mangerons de la viande Nous oublierons la farine de gland !
Ixf useggwas, d-amenzu useggwas A-necfu fell-as, a-neôwu aksum ; a-neppu amalas !
Les enfants parcouraient les ruelles du village, derrière l’un d’eux qui personnifiait ce personnage mythique qu’était « le vieux sage au tesson » qui avait juré fidélité à « mère Yennayer » (yemma Yennayer). L’on raconte que le sage appelé « celui qui dit la vérité » (admu t-tidep) habitait une cité où les femmes étaient brimées et où des manquements à la liberté étaient manifeste au vu et au su de l’Assemblée (Agraw). Comme ceux qui tenaient le pouvoir ne voulait pas revenir à un fonctionnement plus juste de leur Assemblée, « Celui qui dit la vérité » finit par leur dire : « Par le serment des gens qui n’ont pas peur de dire la vérité, que je ne resterai plus jamais dans la cité des dictateurs ! » (Aêeqq kra di-wansen, a taddart iwersusen, ur qqime$ ger-asen !) Il quitta sa cité et s’en alla habiter dans un refuge isolé. Il ne prit avec lui qu’un tesson plein de braises pour se chauffer... Depuis, les Kabyles lui rendent hommage à travers un carnaval qui porte son nom « le vieux au tesson » (am$ar uceqquf). A la tombée de la nuit, les enfants grimés et masqués parcouraient les ruelles de la cité. Les gens étaient tenus de laisser leurs portes ouvertes. Les gens devaient se tenir devant leur maison pour accueillir le groupe d’enfants qui devaient lâcher leur sentence-vérité (awal t-tidep) concernant chaque maison. Les mots étaient parfois très crus (c’est pour cela que les enfants étaient masqués : c’était la voix du vieux au tesson qui s’exprimait. Il s’agissait de rétablir la vérité pour laquelle le « vieux au tesson » - appelé aussi « la sentinelle de la vérité » (aweqqaf t-tidep), avait préféré vivre dans l’isolement et la solitude jusqu’à sa mort.
Exemple de sentence (izli) devant les gens où la maison dont la maîtresse était connue pour sa mauvaise conduite et son mauvais caractère.
Un enfant masqué s’avance et dit :
« Voici les paroles du sage au tesson : « Ô Waâli ! Ô Waâli ! Sache que ta femme est bien vilaine ! Elle n’a aucun charme, elle ne dit jamais la vérité ! Elle est avare et sèche comme un vieil oignon ! Elle tient des propos sur d’autres qui sont bien mieux qu’elle ! En vérité, il faut que tu saches qu’elle ressemble au cul du singe ! » ( A-ta wawal n wem$ar uceqquf :A dda Waâli ! A dda Waâli ! Tameîîut-ik d m-xenfuî ! Ur tesai sser, ur tessi tidep ! P-tamecêaêt teqqur am tebselt ! Thedder yal lehdur af widan i-pyifen ! Ma yella teb$iv tidep, tecba taqerqurt ibekki !) Pour se faire pardonner, la maîtresse de maison devait jouer le jeu et offrait des friandises et des oeufs ! Le maître de la maison leur donnait une pièce. Quand ils terminaient la tournée du village, ils se donnaient rendez-vous dans la cours de l’assemblée. Là, l’un d’eux qui occupait les fonctions de chef (amnay) - cela pouvait être un adulte qui faisait partie du carnaval -partageait entre eux le « butin » fait d’oeufs durs, de gâteaux, de friandises et... de quelques pièces d’argent.
Le rituel du carnaval obéissait aussi à une autre Vérité absolue, appelée « le dû de la vie » (azal n tudert) - qui est le principe du vieillissement qui frappe les Hommes et toutes les choses qui l’entourent et qui sont vivantes sur terre. Dès leur plus jeune âge, il faut que les enfants prennent conscience qu’eux aussi vieilliront. De ce fait découle deux règles. La première est expliquée par le dicton : « C’est la jeunesse qui travaille pour la vieillesse » (p-peméi i-gxeddmen af tem$weô). On apprend aux enfants à préparer leurs vieux jours en travaillant, sous peine de se voir réduits à quémander comme le font les vieux qui n’avaient pas assez amassé de biens pour protéger leurs vieux jours. La seconde est le corollaire de toute éducation kabyle : le respect des personnes âgées et ce quelle que soit leur condition : « qu’elles soient à leur printemps ou à leur hiver » (£as llan di tefsut, xas llan di tegrest).
On voit donc que Yennayer est une fête « déterministe » qui engage les enfants Kabyles et leurs parents à donner le meilleur d’eux-mêmes.
A la fin Yennayer, les enfants étaient envoyés par leur mère chanter par trois fois à l’oreille droite des boeufs de la maison en tapant dans une casserole : « Janvier s’en est allé ô boeuf ! » (Yennayer iffe$ ay azger !). Voici un extrait d’une chanson dédié à Yennayer par les femmes kabyles pour se concilier les bonnes grâces du « souverain des mois ».
LA CHANSON DE YENNAYER
Ô YENNAYER ! ô YENNAYER ! Tu es le maître des champs de blé Ô YENNAYER, ô YENNAYER ! C’est à cause de toi que nous nous bousculons !
Ô YENNAYER, ô YENNAYER ! Mon frère, laisse place à Février Ô YENNAYER, ô YENNAYER ! Ne sois pas dur avec les vieux.
Ô YENNAYER aux bonnes récoltes Tes eaux sont si froides Le pays de mes ancêtres A de tout temps aimé les braves.
Ô YENNAYER comme tu es beau Toi dont le nom est si réputé Les enfants et les femmes t’aiment La montagne te voit comme porteur de bonheur !
Ô YENNAYER ! Ô YENNAYER ! Tu es le meilleur des mois Ô YENNAYER ! Ô YENNAYER ! Sois clément et épargne les exilés.
Toi YENNAYER, paix et lumière Le pays s’appuie sur les traditions Celui qui cherche finit par trouver Là où il y va, Dieu s’y trouve aussi ! CCNA N YENNAYER A Yennayer ! a Yennayer ! Keççini d bab g-iger A Yennayer, a Yennayer Fell-ak i neôwa amdegger.
A Yennayer, a Yennayer Eoo amkan a gma i Fuôaô A Yennayer, a yennayer Taggwadev Öebbi g-gwem$aô
A Yennayer bu ssaba Aman-ik d-isemmaven Tamurt n jeddi d baba I-P ireffden d-irgazen
A Yennayer bu tecrurin A-win mi yezdi yissem Hemmlen-k warrac p-plawin Mi-k yes1a wedrar d ôôsem
A Yennayer, a Yennayer A lexyaô deg-gwagguren A Yennayer, a yennayer Ëader widak yunagen.
A Yennayer lehna tafat Tamurt tedda s tisula Wi nnudan f-kra yufa-t Anda yedda Öebbi yella !
Voici quelques paroles de ma mère à propos de Yennayer : “Sans Yennayer, le bonheur demeure incomplet, car c’est lui qui permet à toute l’année d’avoir son équilibre. Que peut une terre qui n’a pas de reserve d’eau : elle est appelée à souffrir de soif et de sècheresse avant de mourir et de voir mourir les siens”. L’eau c’est la vie. C’est pour cela que le Souverain Suprême a créé la première femme d’une perle de rosée. C’est pour ça que nos ancêtres disaient : “la rosée, c’est la sueur de Yennayer”.” (mebla yennayer, wlac lehcaca di ddunnit ; imi d neppa id yeppaken i wseggwas arkad-is. D-acu i-wi yezmer waka ma yella ur yesƒÕI lufeô d lxezna g-waman : ipeddu ar lmerta n ffad d-uêavum d-u$urar weqbel ad yemmet wad iwali amek pemmaten yidma-s. Aman p-pudert. Af-faya id-yejna Ugellid Ameqqwran tameîîut tamezwarut si tiqit n nnda. Af-faya iqqaren Imezwura nne$ : nnda p-pidi n Yennayer.)
Par Youcef Allioui
Source : http://www.cbf.fr/article.php3?id_article=922
| |
|
|
|
|