|
|
[ Sports/Kabylie ] [ Photos ] [ Famille ] [ Sports/Algérie ] [ Liens/clips/videos ] [ Histoire/Autres ] [ Poésie/Social ] [ Divers ] [ Musique ] [ Culture ] [ Evenements ]
|
|
|
|
Hommage : Il y a 48 ans, Amirouche et Si El Haouès
05/04/2007 02:50

Cela fait déjà 48 ans, le 29 mars 1959 tombaient au champ d'honneur à Bou Saâda, les colonels Amirouche et Si El Haoues, respectivement commandants des wilayas historiques III et VI.
Jeudi dernier, Tassaft Ouguemoune, village natal du Colonel Amirouche, perché sur les hauteurs des Ath Yenni, dans la wilaya de Tizi Ouzou, leur a rendu un vibrant hommage.
C'est sous un ciel d'hiver, qu'une cérémonie de recueillement a été organisée au sanctuaire des Martyrs de Tassaft, localité qui a payé un lourd tribut pour la libération du pays, en y laissant plus de 700 de ses valeureux fils.
Après le dépôt de gerbes de fleurs et la récitation de la Fatiha à la mémoire des martyrs, en présence des autorités locales, des moudjahidine et de familles de chouhada, des intervenants ont pris la parole pour évoquer le parcours du brave combattant, dont la grandeur n'est plus à démontrer.
Tout en rappelant que désormais, l'histoire retiendra que, Amirouche était et demeurera le symbole du sacrifice, les intervenants ont mis l'accent sur le comportement exemplaire du valeureux martyr avec ses djounoud.
" Il était toujours le premier à servir et le dernier à se servir ", témoignent des anciens compagnons d'armes.
De son coté, le ministre des Moudjahidine saisira cette occasion pour dégager une enveloppe de deux millions de DA qui a sera affectée pour la réfection du cimetière du village de Tassaft.
Une enveloppe, qui ne fait que répondre à un engagement fait lors de la commémoration du 47ème anniversaire de la mort des deux héros de la lutte armée de Libération nationale, explique le responsable de wilaya de l'Organisation nationale des moudjahidine, l'ancien Commandant Mohand Ouramdane.
Page d'histoire. Amirouche Aït Hamouda de son vrai nom, est né le 31 octobre 1926 au village de Tassaft Ouguemoune, près de Tizi Ouzou. Dans les années 40, il intègre le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques à l'Ouest du pays et plus précisément à Relizane, ville où il vécut et où il tenait une bijouterie.
En 1950, Amirouche se rend en France, pour travailler, tout en y poursuivant son activité politique. En septembre 1954, il regagne le pays pour participer au déclenchement de la lutte armée de Libération nationale.
Il rejoint le maquis dans la zone de Aïn El Hammam où il prend la tête du commandement en 1955.
Au lendemain de la mort de Mustapha Ben Boulaid, il a été chargé d'une mission, celle de réorganiser militairement la wilaya Une. En 1956, il sera chargé d'assurer la sécurité des membres du congrès de la Soummam.
En 1957, Amirouche est promu au grade de colonel et nommé Commandant de la wilaya III historique.
Cette promotion est intervenue après que Krim Belkacem et Mohammedi Saïd furent appelés à siéger au Conseil national de la Révolution algérienne. Le 29 mars 1959 Amirouche tomba au champs d'honneur au Djebel Thameur à Bou Saâda lui et ses compagnons, alors qu'il se rendait en Tunisie.
Par : Meziane R.
|
Commentaire de claire (03/06/2007 21:20) :
 bonjour me voila prete pour l.hopital mardi mercredi et jeudi
ajustement de médication pour asthme alors je passerai vous voir vendredi
sans faute bisous boop Et mon blog sera ouvert gille et une cop y verra bye
. Sur il sera pas a jour mais pas grave pour une fois vous m.en voudrez pas
bisous boop. bonjour me voila prete pour l.hopital mardi mercredi et jeudi
ajustement de médication pour asthme alors je passerai vous voir vendredi
sans faute bisous boop Et mon blog sera ouvert gille et une cop y verra bye
. Sur il sera pas a jour mais pas grave pour une fois vous m.en voudrez pas
bisous boop.
http://gina.vip-blog.com
|
|
Commentaire de tinhinane (04/06/2007 17:34) :
amirouche c la fierté de tassaft
|
|
Commentaire de samira (13/09/2008 11:03) :
c tres riche tous ces articles et surtous celui sur amirouche; comme c un
parent a ma grande mere ca me fait plaisir de connaitre son histoir
franchement mille bravo a votre travail c est superrrrrrrrrr
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Évocation : Mouloud Mammeri , Un grand écrivain
07/03/2007 03:09
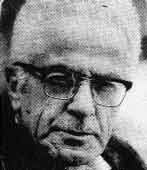
| D’abord l’œuvre en question qui renferme ces deux joyaux de la littérature algérienne d’expression française que sont entre autres La colline oubliée et L’Opium et le bâton se serait augmentée de quelques autres best-sellers, à la grande joie et reconnaissance de ses lecteurs.
Mais c’est surtout son regard d’écrivain sur le chemin accompli par l’Algérie dans le sens du progrès et de la démocratie : une presse indépendante et l’éclosion de jeunes talents, à l’image de Yasmina Khadra sous la poussée démocratique de la mondialisation et les libertés qui en résultent dont bénéficie admirablement la langue amazighe portée par un courant qui inscrit son long et difficile combat au cœur de la citoyenneté qui nous intéresse. Et il est évident que c’est son journal qui se serait enrichi de tous ces événements impérissables de nouvelles pages. A un moindre degré, on pourrait, poursuivant cette supposition, se demander légitimement ce que Mammeri, passant devant la salle Errich où une formidable exposition lui a été consacrée ainsi qu’à son parcours d’écrivain, aurait pensé de cet hommage rendu par la wilaya de Bouira. Se serait-il reconnu dans le portrait dressé de lui par les nombreuses citations tirées de sa propre œuvre (une sorte de Mammeri par lui-même) ou de témoins comme Pierre Bourdieu lui-même.
En tout cas, c’est ce portrait haut en couleurs que nous tâcherons de reproduire ici avec ces citations relevées à la hâte, avec plus ou moins de pertinence car les noter toutes en exige plus de temps et certainement plus d’espace. D’ailleurs, comme pour pallier le défaut d’exhaustivité qui devait leur paraître latent, les initiateurs de ce vibrant hommage, dédié à la mémoire de cet immense plume que fut et reste Mouloud Mammeri, avaient programmé une conférence sur sa biographie et un concours de poésie où les 5 meilleurs poèmes seront retenus et primés. Nous ne le répétons jamais assez : l’œuvre de Mouloud Mammeri né en 1917 et éteint en 1989 est dense et pèse d’un grand poids dans le patrimoine culturel de l’humanité, puisque La colline oubliée et L’Opium et le bâton – pour ne parler que de ces deux grands romans – furent traduits en 11 langues. Autour de la pièce maîtresse de l’œuvre constituée par ces deux maîtres romans, on trouve une pléiade de nouvelles et de contes, publiés chez Plon, Europe, Maspéro ou Bordas, comme La table ronde, La meute, Machaho ; on trouve aussi un précis de grammaire publié à Alger en 1967 et d’autres publications comme Escale, La cité du soleil à la même édition.
Cédant au chant des sirènes de l’ethnographie, Mammeri consacre à la littérature orale et kabyle sept ouvrages entre l’essai et la poésie sur une période comprise entre 1969 et 1989, année de sa disparition tragique (Mammeri rentrait du Maroc à bord de son véhicule lorsqu’il percutait un arbre. Une fin à rapprocher de celle de Camus). Tant de fécondité créatrice et tant de productions ne pourraient laisser indifférent un monde désireux d’honorer partout où il se trouve le génie. En 1986, soit trois ans avant sa mort, l’auteur de L’Opium et le bâton reçoit à l’université de Nanterre (Paris X) le titre de docteur honoris causa en présence de quelques amis, dont J. Yacine et Pierre Bourdieu. A Paris, il fonde la maison des services de l’homme, le fameux centre d’étude et de recherche d’anthropologie de Méditerranée (Ceram) qui publie la revue Awal.
Un portrait haut en couleurs
A côté des nombreuses photos et textes qui illustrent cette expo, ce petit paragraphe attire l’attention : il est de la main de Mammeri même : « Lorsque j’étais enfant, mon père m’emmenait systématiquement au marché parce que le marché est un lieu de rencontres. Le marché de mon père durait une demi-heure ; le reste du temps, il le consacrait à rencontrer les gens et à rester avec eux. Eux en faisaient autant. Il y avait une entreprise de formation dans le tas à la fois consciente et diffuse ». Nous voilà fixés sur le départ dans la vie du jeune Mammeri dont Pierre Bourdieu, dont il fut l’ami, dira plus tard : « En défendant cette sagesse profonde qui s’est logiquement maintenue envers et contre toutes les dominations et en particulier contre la censure du discours religieux, Mouloud Mammeri était loin de sacrifier à une quelconque nostalgie puissante et régressive.
Il avait la conviction de travailler à l’avènement en Algérie d’une démocratie pluraliste soutenue à la différence et capable de faire triompher la parole de l’éclairage national contre le silence buté ou la parole nationale des fermetures politiques et religieuses. » Le même Bourdieu dira à propos de l’écrivain engagé dans sa lutte pour les valeurs universelles : « Mouloud Mammeri s’est trouvé investi en plusieurs occasions critiques de la confiance de tout un peuple qui se connaissait et se reconnaissait en lui. Le poète, disait Mammeri, est celui qui mobilise le peuple et qui l’éclaire. » A quoi souscrit pleinement Mouloud Mammeri : « Mes points de référence ne sont pas politiques. En tant que romancier, ce qui m’intéresse, c’est le destin de l’homme, sa liberté, sa pleine expression ».
D’abord cet intérêt se manifeste devant les atrocités commises à l’époque coloniale : « A chaque page de mon journal (...), la tragédie éclorait d’elle-même. » « Cette grande tragédie » est imputable à « la faute d’un seul grand coupable : le colonialisme » ainsi que le souligne avec vigueur Mammeri dans sa lettre à un Français. Ensuite cet intérêt prend la forme d’une révolte, lorsqu’il est fait fit de la dignité humaine : « Le jour où on est venu nous signifier que nous étions une organisation de masse, j’ai quitté l’union. Comment peut-on conformer comme des moutons dans un parc des hommes, des femmes qui ont un visage, un nom, un cœur ? » Cette révolte prend une envolée lyrique à propos de la langue amazighe qu’il s’agit de défendre bec et ongles : « Il n’était pas possible d’accepter de gaieté de cœur que la langue qui avait servi aux guerriers de Jughurta cessa de chanter sur les lieux mêmes de leur combat par la faute de quelques préjugés rétrogrades. » Ignorance, préjugés, inculture, voilà une thématique à la mesure d’une grande plume.
El Watan 07/03/2007
|
| par Ali D. |
|
Commentaire de Vaddi (08/03/2007 00:34) :
Message de Vaddi - Sujet : « Remerciements et admiration ! »
Azul a ya Rezki, Je n'ai pas un vocabulaire assez riche pour te dire
combien j'ai aimé ce que tu as présenté dans ce blog, surtout la
manière et l'organisation de toutes les rubriques. Je te remercie du
fond du coeur pour m'avoir permis de voyager et revoir ma terre natale
et le Djurdjura. les sujets sont variés et attrayants ! Je te dis encore
bravo !! Je te souhaite beaucoup de réussites ! Ton ami et frère Vaddi
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
La Berbérie
31/01/2007 01:12

| Les protos-berbères d'Afrique : géographie |
| La Berbérie s'étend sur un immense territoire qui s'étend de l'oasis de Siwa (égypte) aux îles canaries. Au sud, elle occupe une bonne partie des pays du Sahel (Mauritanie, Niger et Mali). La population de cette région, les berbères, se nomme "amazigh" qui signifie "hommes libres. Evalué à plus de 30 millions d'âmes elle occupe les régions montagneuses (Maroc, Algérie, Libye) et désertiques (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, mali, Niger, Mauritanie).
Si la majorité de la population marocaine utilise des parlers berbères (le rifain au nord, le berraber et le chleuh dans les atlas), ses sœurs tunisiennes représentent moins de 2% et sont cantonnées dans la région de matmata (sud) et dans l'île de Djerba (berbères musulman de rite kharidjite).
En Algérie, la Kabylie demeure malgré des siècles d'occupation renfermée et hostile à toute pénétration étrangère pratiquant pour une bonne partie un islam très tolérant, elle s'évangélise à un rythme accéléré depuis le début des années 1990. Une minorité juive, y vit également avec une diversité qui ne semble pas inquiéter, la population kabyle ne cesse de revendiquer sa culture et ce durant et après la colonisation française. L'histoire des berbères (imazighène),
Région humide à l'ère néolithique, le Sahara aurait donné naissance à l'existence même de l'homme. L'Afrique aurait été peuplée à partir de la bérbérie à partir du 8ème millénaire et ce jusqu'en 2500, le Sahara sera la seule contrée de tout le continent africain à receler la présence humaine les peintures rupestres du tassili donnent un aperçu évident sur cette réalité. C'est ainsi que des civilisations néolithiques s'y sont développée, les habitants de cette partie représentaient un bloc homogène dit "protos-berbères".Toutefois, deux autres groupes vivaient à l'est et au sud du pays proto-berbères alors que les éthiopides (ancêtres des égyptiens) occupaient la cote nord-est, longeant la mer rouge, les négrides (ancêtres des noirs africains) étaient concentrés dans l'actuelle région du Sahel, c'est à dire dans la partie sud du sahara. L'assèchement de l'actuel désert à partir du 2ème millénaire avant j.c. provoquera l'apparition de deux entités : à peau blanche au nord et noire au sud. Les néolithiques sahariens (ou protos-berbères) possédaient une organisation spécifique à laquelle s'ajoutait des conceptions philosophiques propres. En plus de la chasse cette population, était dotée déjà d'un esprit créateur, outre l'artisanat (poterie), l'agriculture était florissante à l'intérieur du Sahara et la métallurgie du fer n'était pas non plus inconnue. Echanges de commerce à longue distance avec les négrides
L'an 3200 laisse penser que le monde aurait pris donc naissance au Sahara. l'existence du gorille et du chimpanzé, proches parents de l'être humain, trois espèces de singes fossiles qui s'y rapprochent ont été découvert en effet. le proconsul (ou dryopithécus africanus) vieux de 25 millions d'années, le kenyapithécus wickéri (mis à jour en 1961) âgé de 14 millions d'années ainsi que l'australopithèques retrouvé en Afrique orientale et dont l'age est estimé à 4 millions d'années offrent toute la latitude pour soutenir ce dossier. Quant à l'espèce humaine notons aussi ces évolutions :
1)- l'homo habilis : ayant plus d'un million d'années (c'est à dire jusqu'en... 800000 !) est une forme d'australopithèque bipède, il taillait la pierre et les os et de plus sa présence a été uniquement signalé en afrique.
2)- le pithécanthrope : apparu il y environ un million d'années, il a vécu jusqu'en l'an 150000 cet artisan de l'industrie des bi faces ou coups de poing pour la chasse (industrie appelée acheuléennes) s'est répandu en afrique, europe et même en asie mineure.
3)- l'homosapiens : apparu il y a environ 250 000 ans en Afrique, il taillait la pierre.
L'homme moderne (ou homosapiens sapiens) naîtra en -35000 avant J.C. il avait des rites d'inhumation ainsi que des manifestations que l'on peut qualifier de "culturelle".Ses outils de chasse devenaient plus légers, donnant ainsi une grande efficacité à leur utilisation. C'est autour de 55000 avant J.C. qu'il découvrira le feu et c'est en Afrique qu'on constate l'état de ses stades évolutifs qui l'ont précédé et ce depuis les origines les plus lointaines de la lignée humaine.
Les variations climatiques subies par ce continent à la fin du pléistocène permettent en outre d'affirmer que de grands lacs ont existé en -20000 dans le Ténéré aujourd'hui désertique. Les anciennes populations des régions berbères actuelles, capsiennes en cyrénaïque (région nord de Libye) vers 35000, atériens (Maroc et Sahara occidental) datés de 25000 donnent un aperçu fiable sur les premiers humains d'afrique. Les vestiges lithiques appartenant au dernier temps de la préhistoire nous apprennent qu'une évolution démographique a été considérable en -10000 et qu'elle (cette évolution) s'était produite à certaines périodes de l'holocène (à climat humide) et bien entendu au Sahara uniquement. La méthode de datation utilisée avec le carbone 14, mesurant l'isotope radio actif, un résidu du carbone, s'applique également aux restes osseux, aux coquilles et bien évidement au charbon de bois. Celle-ci (la méthode) a donc permis d'aboutir à une idée assez précise de l'évolution climatologique et humaine depuis -11000. Le 3ème pluvial gambien a été suivi d'un épisode sec et froid aussi et ce pendant une durée très courte. C'est vers -8000 que débuterait le nouvel ère humide appelé "optimum climatique saharien"qui aurait une influence déterminante sur l'ensemble du peuplement africain. Entre 8000 et 6000 les pluies seraient abondantes au sahara. Les anciens fleuves qui avaient coulé lors des périodes pluviales du pléistocène seront remplis à nouveau le Sahara, principal foyer de peuplement et dont sa végétation était de type méditerranéenne attirait les populations paléolithiques qui ne pouvaient pas vivre dans des zones marécageuses ou des hautes montagnes par ses réalisations artistiques, l'ancêtre de l'homme développera une civilisation particulière donc remarquable. Le dessèchement du Sahara en -5000 était très lent jusqu'à -250 et par la suite, sa rapidité (rapidité de l'assèchement) provoquera la fuite des populations vers le nord et le sud, des populations nomades qui y avaient prospéré grâce à la chasse, la pêche et l'agriculture se sédentarisent, l'utilisation des meules de pierre et de la céramique en sont les preuves
Il serait utile de distinguer les deux néolithiques, l'européen et le proto-berbère. si en Europe on le mesure par l'opposition de l'âge de pierre (ou pierre taillée), en Afrique, cette époque est définie par la sédentarisation des populations préhistoriques. Ces dernières fauchaient et réduisaient en farine des graminées sauvages qu'elles n'avaient pas semé et étaient conscientes de la valeur alimentaire. Les touaregs (berbères habitant actuellement le Sahara) gardent toujours ce procédé. Certaines régions situées à 500m d'altitude ont été favorables, entre le 8ème et le 3ème millénaire, à l'élevage ainsi qu'à la chasse. L'actuel Ténéré (Sahara toujours) a attiré autour des lacs de nombreux pêcheurs qui ont eu l'idée de cultiver la terre, d'où l'invention de l'agriculture. l'utilisation rationnelle des produits imposera une société hiérarchisée, sous une autorité unique (amghar qui signifie personne âgée ou vieillard), une coutume que l'on retrouve dans les régions berbérophones (rif, atlas, Kabylie, Aurès, île Djerba, mat mata, Tripolitaine, air, Adrar des ifoghas, Hoggar, oasis de Siwa...) d'Afrique du nord et sahélienne .
Les ancêtres des peuls ou foulbés, un peuple résultant d'un métissage entre les négrides et des protos-berbères, ont laissé dans les zones montagneuses du Sahara, des peintures et des gravures rupestres qui démontrent amplement leur vie quotidienne. Certaines peintures du tassili daté du 3ème millénaire qui nous renvoie aujourd'hui à leurs textes initiatiques. En plus de ces métis, des négrides ont aussi vécu dans la région du Sahel (Mauritanie, mali, Niger). A l'est, des humains à peau noire, appelés des "étiopides parviendront à s'infiltrer dès le 5ème millénaire sans subir un quelconque mélange avec les protos-berbères, de couleur blanche, au Hoggar, au tassili des ajers, régions situées en Algérie, aux peuls, ils vivaient une autarcie alimentaire, basée sur les produits de leurs troupeaux. Les mariages entre les trois groupes étaient proscrits. Toutefois, ceux qui s'étaient fixés au Tibesti (au nord de l'actuel Tchad) s'étaient métissés aux négrides donnant ainsi naissance à une nouvelle population, les Toubous ou tédas. Les protos-berbères refusèrent tout lien avec les éthiopides et les négrides. Si les premiers néolithiques égyptiens étaient venus de l'est (Jordanie, Arabie saoudite...), ceux qui sont rentré par la partie occidentale l'ont été des régions berbérophones libyenne, la Tripolitaine, la cyrénaïque et le fezzan. ces protos-berbères demeurent à ce jour dans l'oasis de Siwa (nord-ouest de l'actuelle Égypte) qui délimite le pays berbère à l'est. Ayant conservé leurs us ainsi que leurs coutumes antéislamiques, ils continuent de parler leur langue, le "tamazighth", un parler très proche du...kabyle algérien. Enfin, les protos-berbères utilisaient un calendrier solaire lié à l'agriculture comme le font les berbères des Aures, de Kabylie ou d'autres contrées habitées par leurs frères. le calendrier rendait compte du renouveau de la végétation, élément essentiel de la vie quotidienne et les phénomènes climatiques étaient soigneusement gardés en mémoire . Trois saisons de 120 jours chacune représentaient l'hiver, le printemps et l'été soit 360 jours
Les conditions climatiques actuelles admettent une certaine vie dans le massif central saharien quant à sa partie méridionale comprise entre l'air (niger) et l'énnedi (tchad). Il serait utile de rappeler qu'entre -7500 et -5000, des lacs immenses recouvraient le Ténéré refermant des algues microscopiques qui, consolidés après -5000 sous la forme d'une diatomite (une roche fiable), permettra leur datation le massif central du Sahara abritait entre -7500 et -6000 une faune qui attira les chasseurs qui laisseront des gravures (sud-oranais, tassili, fezzan...) parfois même en grandeur nature. Ces dessins représentant des éléphants, des rhinocéros, des girafes et même des hippopotames prouvant l'existence de ces animaux à une époque très lointaine. Au tassili par exemple, des peintures abstraites jalonnent des façades, naturelles bien sur, de roches. On y trouve des hommes à têtes "rondes"mais significatives tout de même. ces représentations datent de la plus grande humidité du sahara central qui dura rappelons-le de -7500 à -5000. la démonstration de l'art du chasseur proto-berbère est antérieure à l'apparition du peuple égyptien. la poterie retrouvée dans des sites est datée du 6ème millénaire. ils sont tous situés dans la région du sahara central proto-berbère. éxcepté le maroc, le nord de la berbèrie (algérie, tunisie,libye), les plus anciens sites découverts au nord de la bérbérie (algérie, tunisie et libye, exception faite pour le Maroc) sont datés seulement du 5ème ou 4ème millénaire. ceci nous prouve encore que les berbères habitaient en majorité le Sahara humide.
La situation climatique du Sahara méridional commençant à s'assécher, des savanes herbeuses à végétation méditerranéenne coupées de marécages verront le jour des pêcheurs négrides venus du sud s'y établiront ne pratiquant pas l'agriculture, mais excellaient dans la poterie. La faune commencera alors à se modifier. Des gravures découvertes montreront ainsi des chèvres et des bœufs à coté des éléphants qui disparaissaient peu à peu. La phase pastorale antique de l'art rupestre saharien a effectivement prit naissance vers -5500 au tassili et au tadrart. L'homme entamera dès cette époque la pratique de la domestication de certains animaux (chèvres, bœufs...). En 4500, des troupeaux, dont la présence est attestée par des peintures au Sahara central et feront parti du vécu de cette population que nous appellerons toujours proto-berbère. Vers 3200, c'est à dire au début de l'histoire égyptienne, trois grands groupes de population saharienne seront identifiés :
1)- les pasteurs éthiopides cohabitant avec les négrides qui occupent de nos jours une large bande désertique qui s'étend entre le 21èm et le 17ème parallèle c'est à dire depuis la vallée du Nil entre la 2ème et la 3ème cataracte et ce jusqu'à la limite de l'air (nord-est du Niger actuel).
2)- les chasseurs protos-berbères méditerranéens nomadisant dans le Sahara septentrional. La spécialité technique de chacun d'eux (pasteurs, pêcheurs, chasseurs) a engendré des qui n 'ont pas été bien évidement à sens unique. Quant au culte, le dieu-bélier "amon" que l'on retrouve aussi bien chez les égyptiens que chez les protos-berbères laisse penser à ses cornes et ses rayons que nous révèle l'histoire du peuple hébreux dans "les cornes et les rayons de moise". Ceci démontrerait que les juifs ont joué un rôle très important dans le peuplement de l'Afrique C'est pour cela que les juifs et les premiers berbères qui ont vécu ensemble l'ont été dans une harmonie parfaite. Le Sahara central représentait depuis le VII ème millénaire un foyer de peuplement très important du continent africain. Des contacts ont d'autre part été tissés entre les populations proto-berbères et les habitants du nil. Des civilisations très avancées ont existé à cette époque dans l'Égypte. Des contacts humains ont également existé entre les premiers cités et les occupants du littoral méditerranée (crête, Sicile, Sardaigne, corse, malte...). Les liens entre les ancêtres des actuels imazighènes (pluriel de amazigh qui signifie hommes libres), ont été rendus possible par les nombreuses vallées sèches qui demeurait vivantes. Le Sahara septentrionnal a subi un peuplement dense durant ces trois millénaires en particulier dans la région du "Ténéré" (nord du Niger actuel). Toutefois ces habitants n'étaient pas des proto-berbères mais plutôt des négrides qui fuiront plus au sud dès le tarissement de cette région qui était lent depuis 2000 ans. Au début du 3ème millénaire, taillant la pierre vivaient au bord des lacs et des marécages. L'étendue des sites préhistoriques découverts font penser que ces populations, principalement proto-berbère et négride, vivaient dans le faste alimentaire ils connaissaient aussi la conservation des produits de la chasse et de la pêche qu'ils gardaient dans des jarres. Ils stockaient des graines qu'ils réduisaient en farine grâce à un matériel de broyage adéquat composé de pilons, de meules dormantes et de mortiers. Ces graines provenaient de la cueillette de graminées sauvages que ces populations savaient reconnaître comestibles. Des céréales cultivées laissent penser que les proto-berbères ont inventé l'agriculture. Des sites tels que celui de méniet situé dans le Hoggar (habité aujourd'hui par les berbères touaregs) renferment tout un matériel de broyage dont des haches qui servaient de houes. La civilisation néolithique du Ténéré datée au carbone 14 est -2520 a été la première région à subir les affres de l'aridité rapide au milieu du IIIème millénaire
Les ténéréens proto-berbères et négrides se déplacent vers l'ouest (pour les proto-berbères) et le sud (pour les négrides). Ces derniers donneront d'ailleurs naissance aux diverses familles qui peuplent l'Afrique dite "noire" (nigéro-congolaise, adamoua occidental, bantoue...).le tassili et le Hoggar ont connu d'autre part leur peuplement en -2000, soit 500 années après celle du ténéré.
Les populations qui s'y installèrent seraient venues de la côte nord africaine et le dessèchement du Sahara les a poussé à rejoindre cette région peuplée de nos jours par des berbères. Aurès, kabyle, chenoua, Mzab (Algérie), rif, les atlas, sous (Maroc) renferment de nos jours les descendants des proto-berbères à l'ouest de la région de l'actuel Tchad, les descendants des ténéréens quitteront au IIème millénaire le Sahara devenu hostile à toute vie humaine et même végétale. Ils s'installeront au sud du massif de l'air, au talak et dans l'azaouaq, des régions habitées de nos jours par les ancêtres des touaregs qui les chassèrent plus au sud. Les négrides ténéreens donneront naissance aux premiers africains que l'on dénomme aujourd'hui, "haoussa", une ethnie qui occupe le sud du Niger et le nord du nigeria. l'azaouaq, chevauchant l'actuelle frontière séparant le Niger du mali sera "colonisé" par des hommes venus du Hoggar et du tassili par les vallées de direction nord-sud. Plus à l'ouest, la vallée de tilemsi qui relie le Niger à gao (mali), constitue également une autre ligne nord-sud liant le massif central saharien proto-berbère aux négrides térénéens. au mali enfin, des vestiges retraçant les pécheurs du néolithiques existent au nord de ce pays , non loin de la ville araouane.
La Mauritanie est représentée par l'aouker et le tangant qui se trouvent à l'extrême ouest de ce jalon des sites néolitique bien évidement. le premier cité (aouker) démontrera même que l'agriculture a même existé au lieu dit "thichit oualata" vers -1000. il serait aisé aussi d'affirmer que des fragments de fer ont été découvert dans de la poterie. ceci suppose donc que les proto-berbères ont également inventé la métallurgie du fer et ce dès -1240. des harpons et des pointes en fer ont été mis à jours par d'éminents chercheurs à la fin des années 1960
|
| par Rachid Yahou |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Célébration de Yennayer, nouvel an Amazigh à travers l'Afrique du Nord :
10/01/2007 01:52
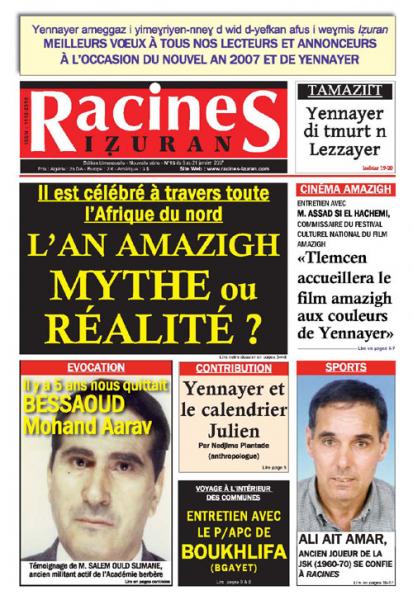
Yennayer : une histoire, une identité et une mémoire pour les Amazighs
«On a vu chez les Berbères tellement de choses hors du commun, des faits tellement admirables, qu'il est impossible de méconnaître le grand soin que Dieu a eu de cette nation» (In : Histoire des Berbères d'Ibn Khaldoun, traduction de Baron de Slane, 1925).

L'histoire d'un peuple ne se limite pas à son histoire événementielle. Chaque civilisation ou culture a parmi ses composantes des facteurs d'ordre cosmique, mythologique et religieux intimement mêlés, qui aboutissent à une vision originale du monde et de l'homme.
On dit que : «Un peuple sans mémoire est un peuple mort». Les chercheurs s'accordent à dire qu'il est très important pour l'évolution culturelle et civilisationnelle des peuples qu'ils célèbrent des dates et événements et qu'ils développent des discours sur leur propre histoire commune.
Alors qu'en est-il du (des) peuple (s) de l'Afrique du Nord à propos de la célébration du nouvel an Yennayer ? Qu'est-ce que Yennayer, quel est son origine et comment est-il fêté par ces peuples notamment en Algérie ?
Nos ancêtres Imazighen n'ont que rarement pris l'initiative d'écrire leur propre histoire et cela jusqu'à l'époque moderne, chose qui pose des problèmes pour nos historiens. Notre société qui est fortement à tradition orale jusqu'à nos jours, ne nous transmet que ce qui est récité sous forme de poèmes, dictons ou de contes… Ce qui constitue une richesse de notre littérature orale mais aussi une fragilité de nos repères à défaut de fixer cette oralité, discours et histoire. Notre histoire est écrite par des envahisseurs à l'exception de quelques écrits à l'exemple du grand sociologue et philosophe Ibn Khaldoun. Mais, aujourd'hui, les Imazighen écrivent leur propre histoire et fixent tout ce qui est voué à la disparition.
Rappel historique
La plupart des historiens nous apprennent que l'Afrique du Nord est entrée dans l'histoire avec l'apparition des Phéniciens sur ses rivages, c'est-à-dire à la fin du XIIe siècle avant J.-C. Selon d'autres, tel Victor Piquet dans «les civilisations de l'Afrique du Nord», «Les Libyens avaient, dès le XIVe siècle avant J.-C., une civilisation et une industrie. Ils avaient déjà des rois héréditaires et avaient conclu avec les peuples des îles, avec les Tyrrhéniens en particulier des alliance profitables».
Les rapports avec le monde Libyen ou Amazigh et le monde Pharaonique semblent remonter à la première dynastie Thinice, aux environs de 3300 av. J.-C. Au temps de la 19e dynastie, en particulier sous le règne de Ménoptah, vers 1232-1224 av. J.-C. Les Pharaons repoussèrent une attaque des Lybiens/Berbères auxquels s'étaient associés les « peuples de la mer ». Mais la ténacité des Berbères finit par venir à bout de la résistance Egyptienne puisqu'en 950 ans avant J.-C., Chechnaq 1er (un libyen/Berbère) s'empara du Delta du Nil et fonda la 22e dynastie libyenne. (Première hypothèse) ? Il existait une situation conflictuelle à la frontière Est de la Libye; (c'est la deuxième hypothèse). Avec toutes les guerres entre les Libyens/Berbères et les Pharaons, et chaque fois les tribus Berbères de l'Est réussirent à vaincre l'armée pharaonique d'Egypte et à s'installer (occuper) son territoire. Après des guerres (batailles) sanglantes, les deux peuples décidèrent de mettre fin à ces conflits.
Célébration de Yennayer
Yennayer qui est aussi dit en Kabyle Tabbwurt Useggwas. Amenzu n Yennayer est le premier jour de l'an berbère. Yennayer ou Nnayer pour certain qui coïncide avec le 12 janvier du calendrier grégorien (chrétien) est célébré partout en Algérie bien entendu différemment mais aussi au Maroc. Yennayer est une occasion de fête, de liesse populaire voire d'un carnaval, comme à Tlemcen.
Dès l'approche de Yennayer comme pour bien l'accueillir, on repeint l'intérieur des maisons, on nettoie, on change tout ce qui est vieux et usé notamment le support de l'âtre (Inyen)…etc. Il est souhaitable lorsqu'arrive Yennayer que toute entreprise soit terminée : par exemple, un métier à tisser.
Yennayer c'est surtout l'occasion de célébrer certains rites : ici et là, des genêts (Uzzu) sont déposés sur les toits des habitations afin d'empêcher la malédiction d'entrer dans les foyers… C'est aussi l'occasion d'une part, d'un retour à la terre-mère, la terre nourricière, et, d'autre part, d'une communion populaire.
Il faut savoir qu'en Kabylie la célébration de Amenzu n Yennayer est marqué par un rite d'émulation du sacrifice propitiatoire, destiné à chasser les forces maléfiques Asfel. A travers Imensi n Yennayer (le souper de janvier) on présage l'abondance pour toute l'année, on tient à avoir ses récipients bien garnis et il serait inconvenant de se montrer avare.
Des mets de circonstance sont préparés : couscous au poulet, ou encore de la viande séchée acedluḥ. A ce plat, on peut ajouter un autre constitué par des crêpes (aḥeddur, tighrifin, acebbwad). Uftiyen (soupe préparée à partir de poix chiches, de fèves et de pois-cassés), de la Talabagat (viande hachée), accompagnés d'un Aghagh (jus), de Tagella (pain), Tighrifin (crêpes), de gâteaux et autres divers beignets… reunissent toute la famille autour d'un banquet comme en Oranie.
Imensi n Yennayer est un repas de famille, on met à part ce qui revient aux filles mariées au dehors, et on dispose les cuillères des absents pour se souper ensemble.
Dans certains endroits, le premier jour, Amenzu n Yennayer, on ne mange que des produits végétaux : la viande est laissée pour le lendemain. On se gave de fruits secs : figues, raisins, noix, dattes. Au Maroc, dans certains foyers, on mange « les sept légumes ».
A Tlemcen, un autre rite est pratiqué «le carnaval d'Ayrad» (Ayrad : le lion). Les enfants se masquent à l'aide d'une courge évidée, percée de trous pour les yeux et la bouche ; on colle des fèves qui seront des dents et des poils de chèvre pour la barbe et les moustaches. Ils vont par petits groupes à travers les ruelles et font des collectes. Seulement avant de quitter chaque foyer, l'assistance prie pour les gens malades, les démunis et ceux qui n'ont pas d'enfants. Ils reprendront le chemin de sortie de chaque foyer vers la ruelle en criant Ayrad ! Ayrad ! Ayrad…en dansant…etc., jusqu'au matin (du 13 janvier). Pour les enfants aussi, c'est l'occasion de s'offrir et d'offrir de beaux habits neufs et autres cadeaux notamment aux jeunes filles, comme dans l'Ahaggar et dans d'autres régions du pays.
A ce jour, Yennayer est célébré partout en Algérie – de Kabylie à l'Ahaggar, d'Annaba à Tlemcen… en même temps c'est-à-dire entre le 11 au 13 janvier.
Yennayer : une date, un symbole, une tradition, une histoire, une identité, une fête, un repère et une mémoire pour les Africains du Nord en général et les Algériens en particulier.
Mais aujourd'hui, qu'en est-il de son officialisation comme date commémorative nationale en Algérie au même titre que les autres fêtes dites «légales» ?
Boussad Berrichi (Universitaire - Paris)
|
Commentaire de Chanou (10/01/2007 06:32) :

Bonne journée mes amis(es)
Je vous fais de gros bisous!!
Amitié Chanou!!
Toujours aussi enrichissant ici..bisous!!
http://melancolique1.vip-blog.com
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Comme un reméde
07/01/2007 04:36
" Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. "
John Fitzgerald Kennedy
| Source |
Discours inaugural, 20 janvier 1961 |
http://www.linternaute.com/citation/3745/ne-demandez-pas-ce-que-votre-pays-peut-faire-pour-john-fitzgerald-kennedy/
|
Commentaire de justine (15/11/2007 16:48) :
Bonjour,
mon grand oncle, né en algerie, était visiblement la bas un grand ecrivain,
plutot tendance philosophe penseur, a priori tres dérangeant pour le
pouvoir en place pendant la guerre
j'ai appris il y a tres peu de temps qu'il aurai été assassiné, a
cause de ses pensées, à alger.
Je n'ai pas beaucoup de renseignement, je ne connais que son nom et
prenom et n'arrive pas a trouver des traces de son histoire
je me sens pourtant tres proche de lui et aimerai en savoir plus, seriez
vous en mesure de m'aider?
par avance merci et bravo pour votre blog
crystaleuh@hotmail.com |
| |
|
|
|
|
|
|
|
À l’origine de l’histoire de Tizi Ouzou
29/12/2006 16:43

| LES FESTIVITÉS ONT DÉBUTÉ HIER LIBERTE 28/12/2006 |
| À l’origine de l’histoire de Tizi Ouzou |
|
 Un colloque sur ce thème animé par des personnalités historiques est l’un des moments forts qui marque ces manifestations. Un colloque sur ce thème animé par des personnalités historiques est l’un des moments forts qui marque ces manifestations.
Si la commémoration du 366e anniversaire de la fondation de la ville de Tizi Ouzou a été inaugurée mardi soir par la traditionnelle retraite aux flambeaux des Scouts musulmans algériens (SMA) et la prestation de troupes folkloriques à travers les principales artères de la ville, les grandes festivités ont débuté, hier, à la maison de la culture Mouloud-Mammeri où il fut procédé, en présence du wali de Tizi Ouzou, du président de l’APW et du président de l’APC, à l’inauguration d’une belle exposition de photos anciennes de Tizi Ouzou et le vernissage de tableaux d’artistes peintres tizi ouzéens.
L’un des moments forts de cette manifestation, qui s’étalera durant quatre jours, réside certainement dans l’ouverture d’un colloque relatif à l’histoire de Tizi Ouzou, depuis sa création sous l’empire turc en 1640 jusqu’à nos jours.
Intitulé “Tizi Ouzou se raconte”, ce colloque sera animé par plusieurs personnalités bien connues, telles que Cheikh Bouamrane, président du Haut Conseil islamique qui traitera de “L’histoire léguée par anciens scouts fondateurs du scoutisme algérien”, Youcef Merahi, secrétaire général du HCA, qui livrera des “Impressions tizi-ouzéennes”, Abderahmane Khelifa, archéologue et historien, qui débattra sur “Tizi Ouzou et sa région durant l’Antiquité”, alors que de vieilles figures de Tizi Ouzou animeront d’autres conférences-débats tout aussi intéressantes car traitant de sujets historiques tels que “Tizi Ouzou à l’époque ottomane”, “Tizi Ouzou durant la colonisation française”, “La naissance du scoutisme à Tizi Ouzou” et bien évidemment, “La création d’un club nationaliste, la JSK”.
Et pour couronner tel qu’il se doit ce cycle de conférences-débats, Salah Mekacher, ex-officier de l’ALN et ancien secrétaire du PC de l’ex-Wilaya III historique pour le commandement du chahid le Colonel Amirouche, devait aussi traiter d’un thème très liée à l’histoire de Tizi Ouzou, intitulé “Histoire d’un combat séculaire” pour rappeler justement le sacrifice de tous les jeunes de Tizi Ouzou, qu’ils furent scouts, étudiants ou sportifs, et qui ont sacrifié leur vie dans les maquis de l’ALN pour que vive l’Algérie indépendante. C’est dire qu’à la veille de la célébration des joyeuses fêtes de l’Aïd El Adha et du nouvel an, l’Association des anciens scouts de Tizi Ouzou, nouvellement créée, aura réussi un grand pari pour ressusciter l’histoire de la “Ville des Genêts”, depuis la construction du Bordj Turc par Ali Khodja, jusqu’à l’insurrection des Amraoua, la prise de Tizi Ouzou par le général Randon, puis la Guerre de Libération nationale et la période post-indépendance jusqu’à nos jours.
|
| par Mohamed Haouchine |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Le Nouvel an berbère (Yennayer Imazighen)
24/12/2006 05:59

- Les Imazighen (mot qui veut dire berbères) Mashaouash, Libous orientaux de Cyrénaïque étaient en contact direct avec l’Égypte ancienne.
- En 1200 avant J.C. la civilisation libyque avait même boulerversé l’équilibre de la Méditerranée orientale en envahissant l’Égypte.
- C’est à cette époque que les Berbères inventèrent une roue inconnue jusqu’alors et apprenaient aux Grecs à atteler quatre chevaux.
- A la fin de la XXIème dynastie égyptienne, Sheshonk (Chachnaq 1er), grand chef militaire des Mashaouash, obtint du Pharaon Siamon, dont l’armée était en grande partie composée d’Imazighen (berbères), l’autorisation d’organiser un culte funéraire pour son père Namart, un privilège exceptionnel.
- A la mort de Psossenes II en 950 av. JC qui avait succédé à Siamon, Sheshonk s’attribua la dignité royale et fonda la XXIIème Dynastie qu’il légitima en mariant son fils, Osorkon, la fille de Psoussens II, la princesse Makare et installa un autre de ses fils comme grand prêtre d’Amon Thèbes.
- Sheshonk établit sa capital Boubastis, installa les hommes de sa tribue dans des terres du delta du Nil et leur constitua des fiefs.
- Une nouvelle féodalité prit pied en Égypte.
- L’an zéro amazigh se réfère donc à cette date historique de 950 av. JC ou Sheshonk fut monté sur le trône et fonda la XXIIème Dynastie.
- Le Jour de l’An le 12 yennayer : tibbwura useggwas
  
- YENNAYER remonte selon les chercheurs à 950 AV-JC. Il y a deux hypothèses avancées par les chercheurs. La plupart des historiens nous apprennent que THAMAZGHA ( Maghreb) est entrée dans l'histoire avec l'apparition des phéniciens sur ses rivages, c-à-d a la fin du XII siècle AV-JC. d'autres, cependant, nous disent tel Victor Piquet dans "les civilisations de l'Afrique du nord", que " les libyens avaient, des le XIV siècle AV-JC, une civilisation et une industrie.
- Ils avaient déjà des rois héréditaires et avaient conclu avec les peuples des îles, avec les Tyrrhéniens en particulier des alliances profitables".
- On sait aussi que, vers 3300 AV-JC, la première dynastie limite eut fort à faire pour les empêcher d'envahir l' Égypte et qu'au temps de la 19e dynastie, sous le règne en particulier de Méneptah ( Pharaon de la XIXe dynastie, fils de Ramsès II), vers 1235-1224 AV-JC, les Pharaons repoussèrent une attaque des libyens auxquels s'étaient associés les " Les peuples de la mer".
- Mais la ténacité des Amazighs finit par venir à bout de la résistance Égyptienne puisqu'en 950 AV-JC.
- L'Amazigh, Chachnaq 1er, le Sénac de la Bible, s'empara du Delta du Nil et fonda la 22e dynastie libyenne.
- Il existait une solution conflictuelle à la frontière EST de la Libye, c'est la deuxième hypothèse.
- Avec toutes les guerres entre les Amazighs et les Pharaons, et chaque fois les tribus Amazighs de l'EST réussirent à vaincre l'armée égyptienne et à s'installer (occuper) sur son propre territoire.
- Après les dures épreuves que les deux peuples ont subi, des guerres sanglantes, les deux peuples décidèrent de mettre fin à ces conflits, ils ont préféré le fêter en égorgeant des coqs.
- Traditions qui sont restée jusqu'à aujourd'hui, ou nous fêtons Yennayer avec des dîners en poulets (Imensi S -Uyazid).
- Et tout ça s'est été passé vers 950 AV-JC.
- Ce qui fait que l' An Amazigh est 2957 avec 950 ans d'intervalle avec l'ère Chrétienne 2007.
- Mais cette avance de 950 ans est-elle méritée et souhaitée dans la réalité ?
- Donc, il est temps que les Amazighs prouvent cette avancée d'existence dans différents domaines.
|
Commentaire de nani283 (30/09/2008 19:47) :
j'aime se que t'écri
|
| |
|
|
|
|