|
|
[ Sports/Kabylie ] [ Photos ] [ Famille ] [ Sports/Algérie ] [ Liens/clips/videos ] [ Histoire/Autres ] [ Poésie/Social ] [ Divers ] [ Musique ] [ Culture ] [ Evenements ]
|
|
|
|
Un trouvère kabyle au « pays du soleil froid »
12/05/2008 00:16

Rencontré chez lui en plein milieu de Montréal, Belkacem Ihidjaten est un homme de sens rassis, sagace et bien dans ses « babouches ». Comme diraient certains pince-sans-rire. Le sourire aux lèvres, il m’accueille les bras ouverts. Et m’invite to de go à m’attabler derrière sa demeure, dans ce qu’il aime appeler «son petit coin de Kabylie », un jardin soigneusement entretenu où poussent des figuiers, des poiriers et quelques légumes. Le front prématurément dégarni, la chevelure entièrement grise, le teint légèrement bronzé, le geste naturellement mesuré, l’homme inspire le respect et en impose en même temps. À cause peut-être de ce je ne sais quoi, difficilement définissable, consubstantiel aux personnalités des poètes, de tous les poètes.
Il faut savoir que dans la culture berbère, les croyances populaires, encore très vivaces, les assimilent encore et toujours à des êtres surnaturels ou du moins en contact, permanent ou épisodique, avec toutes sortes de génies du verbe et de la rime. Sans vouloir être excessif, ils ne sont pas seulement que révérés, mais carrément craints. Il ne faut même pas penser les offusquer. On ne sait jamais !
Même si je ne l’avais jamais rencontré auparavant, le courant passe immédiatement entre nous. Pour être tout à fait sincère, j’avais l’étrange impression que l’on se connaît depuis des lustres. Tellement sa manière d’être m’est familière. Un peu comme de vieux amis qui se retrouvent après des années de séparation. S’exprimant, indifféremment, en français et en berbère, notre discussion part sur les chapeaux de roue. Et c’est vraiment le cas de le dire. Car, par moment, afin de ne pas trop s’éparpiller en vaines digressions, je me battais les flancs, autant que faire se peut, pour cadrer notre échange. Sans forcément incommoder mon interlocuteur. L’appréhension du poète peut-être !
Sans affectation aucune et sans jamais se départir de ce bagout propre aux Méditerranéens, nous n’avons de cesse de discuter, des heures durant, de son cheminement créatif. Même si vraiment rien, de son propre aveu, ne le prédisposait à devenir un versificateur verveux et prolixe. Il se surprend lui-même, sincèrement, encore aujourd’hui, de tous les échos positifs qu’a rencontrés son œuvre ici et là. En tous les cas, pour lui, devenir poète «n’était dû qu’au hasard ». Un peu comme toutes les bonnes choses de la vie «ça n’a jamais été une entreprise mûrement réfléchie, c’est venu comme ça, tout naturellement».
Guerre et « vie »
Ouidja Boussad, de son vrai nom, est né un 11 juillet 1956 à Guendoul, un petit village, au fin fond de la Kabylie. Connue pour être extrêmement jalouse de son identité et de sa liberté, cette région du Nord de l’Algérie, désespérément et rageusement berbère, en a fait voir des vertes et des pas mûres à tous les colonisateurs qui osaient s’en approcher et a fortiori l’assujettir. Encore au jour d’aujourd’hui, elle continue à donner du fil à retordre au pouvoir central algérien. Bien que celui-ci use et abuse, tantôt, de la politique du bâton et, tantôt, de l’achat tous azimuts des consciences et des âmes. En fait, aussi loin que l’on remonte dans le temps, la Kabylie a sans cesse eu des rapports conflictuels avec toutes les forces qui voulaient lui mettre le grappin dessus. Et ce n’est pas près de changer.
D’ailleurs, la naissance de notre habitant du Pinde a coïncidé avec un autre conflit, autrement plus cruel. Il s’agit de celui qui a été lancé contre la France, la puissance occupante d’alors. Un véritable casse-pipe où se sont engagés les meilleurs enfants de la Kabylie. Sans aucune hésitation, massivement, corps et âme. « Ce n’est pourtant pas du fait de cette guerre que j’ai perdu mon père», m’avoue-t-il sans aucun trémolo dans la voix. « Je ne l’ai jamais connu, car il est décédé alors que je n’avais en tout et pour tout que 40 jours », ajoute-t-il. Placidement. Froidement. Sans que cela soit vécu comme un drame. C’est du moins l’impression qu’il donne.
À quelque chose malheur est bon, le petit Belkacem, en «sa qualité » d’orphelin et grâce -il faut quand même le préciser- au coup de piston salutaire d’un cousin éloigné, a été inscrit en 1962 à l’école primaire d’Imzizou, non loin de son village natal. Dans une Kabylie, appauvrie et saignée à blanc par huit longues années de guerre. Ce qui était à l’époque, comme on peut bien l’imaginer, un privilège que peu d’enfants de son âge pouvaient s’offrir. «Si je n’étais pas entré à l’école, en ce moment où je vous parle, j’aurais déjà une longue ‘’carrière’’ de berger derrière moi », reconnaît-il, ironiquement. « Ce qui n’aurait pas été vraiment grave. Qui sait ? Mon destin aurait peut-être été mieux », continue-t-il en esquissant un sourire fugace.
À la bonne école
Même s’il était scolarisé, il avait eu malgré tout sa part dans le «dur » métier de berger. Puisqu’il était le plus jeune de la fratrie, il devait donc garder les animaux domestiques de la famille. Comme tous les petits campagnards berbères de son âge. Mais rassurez-vous, ce n’était nullement une perte du temps. Loin s’en faut. Car, tout en gardant ses moutons, il a eu l’occasion de découvrir en même temps, grâce notamment aux bergers plus âgés, le patrimoine poétique kabyle.
Un précieux trésor charriant, depuis des temps immémoriaux, le génie créateur du peuple berbère et célébrant, dans toute sa splendeur, sa geste immensément riche. Dont bien évidemment les poèmes de l’aède légendaire Ssi Mhend Ou Mhend. D’ailleurs, à y regarder de plus près, la patte de ce dernier est on ne peut plus patente dans la poésie de notre amant des Muses. « Être berger était une petite école où j’ai appris énormément », résume-t-il, laconiquement, en assumant pleinement ce qu’il était.
Qui plus est, «les Kabyles sont tous quelque part des poètes », énonce-t-il très affirmatif. En fait, il n’a pas vraiment tort. Comme dans toutes les sociétés traditionnelles de par le monde, la poésie a eu et a de tout temps une place prépondérante dans toute production symbolique. Et les Kabyles, dans ce cas précis, ne dérogent pas vraiment à la règle. La poésie balise systématiquement tous les moments tristes ou heureux de leur vie. Pour les sceptiques, qu’ils testent le premier kabyle qu’ils croisent. Ils seront vraiment surpris !
Il ne faut pas non plus omettre le rôle de la radio dans cette initiation poético-musicale. Pour la télévision, elle n’était pas encore en vogue à cette époque-là. En tous les cas, même lorsqu’elle a été créée des années plus tard, les Kabyles n’y avaient tout simplement pas accès. En raison de l’idéologie intrinsèquement et ouvertement anti-berbère (feu Boumediène par exemple avait interdit l’usage en public du berbère) du régime algérien. La situation a-t-elle évolué depuis ? Oh que non ! Hélas, elle n’a pas bougé d’un iota. Nonobstant les discours pléthoriques et les promesses sans lendemain.
Reste que les premières années de l’indépendance, la radio publique algérienne- la chaîne 2 plus exactement- passait la musique berbère à des moments où justement le petit Belkacem gardait, tranquillement, ses moutons dans les hauteurs spacieuses de la Kabylie. « C’est-à-dire entre 6 heures et 9 heures du matin ; 15 heures et 21 heures. On écoutait Cheikh Nourdine, Chérif Khaddam, Nouara, Mohamed Saïd Ou Saïd... Mais Aït Mengelluet, malgré les reproches que l’on peut faire à l’homme, reste le poète qui m’a le plus marqué, car c’était et c’est toujours, à mon propre avis, un très fin connaisseur de l’âme berbère », explique-t-il admiratif.
Plus que fasciné par toute cette génération de chanteurs plus doués les uns que les autres, Belkacem, en autodidacte qui en veut, a décidé, en 1968, de fabriquer, tout seul, son instrument à cordes -une petite mandoline pour être plus précis- avec des matériaux de récupération. « C’était suffisant pour jouer mes premières notes », se rappelle-t-il les traits subitement rieurs. Et comme le hasard arrange bien les choses, son frère aîné a réussi, par on ne sait quel miracle, à se procurer une guitare qu’il cachait, indiquons-le, dans un galetas en dehors de la maison familiale. « Car il est hors de question de jouer de la musique en famille et encore moins en public. À cause de l’image dépréciative, voire péjorative, qu’ont les chanteurs dans l’imaginaire populaire. En fait, ce n’est pas les enfants bien nés qui deviennent des chanteurs. À telle enseigne que c’est quasiment assimilé à un déshonneur ineffaçable », précise-t-il sans épouser le moins du monde cette vision éculée des choses.
« Je n’avais pas trop le choix : si je voulais continuer ma passion, il fallait donc faire les choses, systématiquement, en cachette et me méfier de tous ceux qui pouvaient me dénoncer à la famille, se souvient-il amusé. Un jeu du chat et de la souris s’engagea alors avec mon entourage. Un exemple. En pleine chaleur torride de l’été, même si c’était cocasse comme situation, je n’hésitais pas à mettre mon burnous de laine épaisse pour une seule et unique raison : y dissimuler, discrètement, la guitare que je dérobais à mon frère, car lui non plus n’était point au courant. »
Écolier consciencieux
Chemin faisant, pour suivre sa scolarité, il est obligé de rejoindre tout naturellement le collège de Mekla, à quelques encablures de son village. En même temps, sa maîtrise de la guitare étant devenue assez suffisante, il était donc systématiquement sollicité pour animer les fêtes scolaires. « Ma première présentation publique a été dans le cadre des activités culturelles de mon collège : j’ai accompagné une camarade de classe, très douée d’ailleurs, pour interpréter l’une des dernières chansons d’Aït Menguellet à cette époque-là ; nous avions fait, tous les deux, bonne impression », note-t-il, un rien fier de son exploit.
Dans le village, et surtout dans les mariages pendant les vacances estivales, c’était lui qui faisait systématiquement de l’accompagnement, mais toujours en retrait, en catimini. « Il faut tout faire pour que cela ne se sache pas, à cause de cet interdit absurde qui frappe la musique et les musiciens », explique-t-il. En disant cela, il se lève tout d’un coup et part, à la hâte, chercher sa guitare d’une prestigieuse marque à l’intérieur de la maison. Et ce pour interpréter, excellemment bien, quelques morceaux de son répertoire musical. Avec ses rythmes berbères délicatement tristes, qui arrachent forcément une larme ou deux si on est un tantinet sensible. Un moment après, il s’arrête tout d’un coup et dit, pédagogue : « En langue berbère, on ne joue pas la guitare, mais on la frappe ( kkat), pour en sortir peut-être toute la tristesse qui nous habite et toutes les blessures qui se cachent dans les plis de notre âme. »
Exceptionnellement doué en mathématiques, le jeune Belkacem s’inscrivit, en 1974, au lycée technique de Dellys, l’un des hauts lieux de formation de la future élite algérienne post-indépendance. Et qui dit élite, dit forcément un traitement de faveur. « Vu le programme très chargé à coups de matières scientifiques (mathématiques et physique), le lycée était pourvu d’un corps enseignant très compétent et de toutes sortes de commodités pour y rendre notre passage moins ardu. D’ailleurs, il possédait une salle de musique extrêmement bien équipée où j’avais l’occasion, pour la première fois de ma vie, de toucher à tous les instruments de musique : mandoline, banjou, luth, basse... », se remémore-t-il, timidement rêveur.
À ses débuts au lycée, il a commencé à tâter le terrain de la création. Il n’a donc pas hésité à griffonner sur papier ses premiers vers. Sur quoi portent-ils ? « Les amours de jeunesse bien évidemment, les contingences de la vie et les soucis quotidiens, souligne-t-il. Certains de ces poèmes sont sous forme de chansons que je vais un jour éditer. En tous les cas, je vais saisir tout ce que j’ai écrit dans les années 70 pour en faire un recueil. J'en ai gardé une grande partie dans mes archives personnelles. »
Émoi
Pour autant, comme on l’a souvent appris nous-mêmes à nos dépens, la vie n’est malheureusement jamais un long fleuve tranquille. Le lycéen privilégié qu’était Belkacem, a eu le premier choc de sa vie. Il faut bien que cela arrive, comme diraient certains cyniques. C’était en raison de l’arrestation du groupe de Mohamed Haroun en 1976, un ancien élève du lycée de Dellys, accusé d’avoir posé des bombes dans certains édifices de l’État algérien. Justement pour protester, dans un geste désespéré, contre la politique anti-berbère du régime de l’ex-président Boumediène.
Ce jour-là, tous les services de sécurité que comptait le régime algérien ont fait une descente impressionnante dans ce fameux lycée d’habitude on ne peut plus paisible. Encerclé de toutes partes, il est passé méticuleusement au peigne fin et ses 400 élèves, tous kabyles, terrorisés des heures durant. Pour preuve, ils ont subit toutes sortes d’interrogatoires, plus musclés les uns que les autres. Ce qui ne pouvait ne pas laisser des traces indélébiles sur de jeunes adolescents à la fleur de l’âge.
« Pour vous donner une idée de ce que nous avons subi : tous nos matelas ont été mis en charpie à la recherche de tout document en berbère. Pour éviter tout problème, j’ai été obligé, la mort dans l’âme, de jeter le seul dictionnaire berbère que je possédais», regrette notre troubadour des temps modernes. Toutefois, tout n’était pas noir, car à cette même époque il s’essayait au métier de compositeur. « En 1976 plus exactement, j’ai écrit, rapporte-t-il, quelques chansons dans notre bon vieux style traditionnel que j’ai données gracieusement à quelques chanteurs que je connaissais. »
Son baccalauréat en poche, il dut encore une fois déménager en quittant, cette fois-ci, sa Kabylie natale. Direction l’université d’Alger. Issu d’un lycée prestigieux à cheval sur l’excellence, son passage y a été quasiment une promenade de santé. Il a même été dispensé de plusieurs matières. C’est vous dire. Ayant plus de temps libre, il ne s’est jamais séparé de sa guitare. Toujours en bandoulière, il écumait systématiquement les soirées estudiantines. Sans jamais négliger ses études. Bien évidemment. Car, au bout d’un parcours forcément sans faute, il décrocha, haut la main, son diplôme d’ingénieur.
Il fallut donc penser à l’inéluctable service militaire. Et là, sa guitare allait lui être d’un grand secours. « Lors d’une présentation musicale privée, un haut gradé de l’armée, kabyle lui-même, qui était présent par le plus grand des hasards, a trouvé mon jeu de guitare excellent. S’informant sur mon cas, il a décidé que je devais passer mon service militaire à Alger même. Et pas n’importe lequel. J’ai été chargé d’une mission extrêmement délicate et importante : avoir la responsabilité du transport de tous les impressionnants engins destinés à la construction du monument dédié aux martyrs en plein centre d’Alger», explique notre rimailleur des monts du Djudjura. « Sinon, dans la caserne, nous ne sommes pas restés les bras croisés, ajoute-t-il, nous avions monté un orchestre qui participait, régulièrement, à toutes sortes de festivités à caractère officiel. »
Libéré, enfin, de ses obligations militaires et encore pratiquement frais émoulu, il est nommé immédiatement à Djelfa, aux confins du Sahara. Mais au bout de neuf ans de bons et loyaux services, il demanda sa mutation qu’il n’a obtenue qu’après avoir mis sa démission sur la table. Un homme de caractère ? Certainement. Même s’il va s’en défendre. Muté donc au Nord-Ouest algérien, et plus exactement à Oran, il est promu directeur d’une entreprise publique. Avec… 150 personnes sous sa responsabilité.
Vu qu’il en avait les moyens, il ne s’est jamais empêché de voyager un peu partout. Parmi ses destinations les plus prisées : l’Europe et l’Afrique figurent en haut de la liste. Sans vouloir succomber au cliché, ne dit-on pas que les voyages sont formateurs ? Ce n’est certainement lui qui va le nier. Mais côté poésie, c’était une très longue traversée de désert. En revanche, la guitare était fréquemment présente. Peut-il en être autrement ? Car il faut voir comment il en parle. Que des éloges à n’en pas finir ! Toujours est-il qu’avec des amis ou des collègues, kabyles ou pas, des soirées sont régulièrement organisées. « Histoire de passer un bon moment ».
Et le terrorisme s’en mêle
Il en sera ainsi jusqu’à l’irruption violente, au début des années 90 du siècle passé, de l’hydre terroriste, qui a fauché, impitoyablement, des milliers de vies innocentes. Dont celles de deux des plus proches amis de notre chansonnier. « Massacrés d’une manière on ne peut plus barbare ». Ayant reçu lui-même des menaces de mort, il fallait donc sauver sa peau. Aucun autre choix, il faut déguerpir. Dare-dare. Hic et nunc. Il vint s’installer avec femme et enfant- il en a juste un seul- «au pays du soleil froid », le Québec.
Passés les premiers mois de son établissement à Montréal, la désillusion commença à pointer son nez. Comme tout immigrant nouvellement arrivé, il a eu énormément de difficultés à trouver un travail correspondant à ses qualifications. Il a fallu en conséquence se trouver une occupation pour tuer le temps, lui, qui était toujours occupé. En fait, il n’avait jamais imaginé qu’il se trouverait, un jour, dans une telle situation. « J’ai commencé, relève-t-il, à écrire des poèmes que je ne prenais jamais la peine de finir. Si je les avais tous finis, j’aurais certainement publié 100 livres. » À la même période, la rencontre avec un compatriote kabyle, et poète de son état, changera radicalement l’idée qu’il se faisait de lui-même. « Une petite comparaison entre nos poèmes m’a convaincu que je faisais mieux, se rappelle-t-il. Cela m’a encouragé à aller de l’avant et à penser sérieusement à la publication. »
Même s’il refuse, avec beaucoup d’entêtement, de temps à autre, l’étiquette de poète, passer à l’écriture était loin d’être une chose aisée. Au fond, moins pour le caractère essentiellement oral de la culture berbère, qu’en raison du poids oppressant du contrôle social et des traditions avec leur lot d’interdits. « Car je brise cette tradition, absurde au demeurant, qui veut que je ne fasse pas de la poésie, note-t-il. D’ailleurs le premier livre a été, pour moi, une torture parce que la brisure est profondément ancrée en moi ». « Écrire est un problème, publier en est un autre », résume-t-il nerveusement.
« Hymne à ma culture »
Que ses fidèles lecteurs le tiennent pour acquis, en ce moment même, il est en train de faire un livre témoin où il va compiler ses meilleurs poèmes, choisis par quatre personnes différentes. « Alors que je m’attendais à ce qu’il n’en y ait pas suffisamment, je me suis trouvé avec un nombre important de poèmes », s’étonne-t-il, pas encore convaincu par la qualité de sa poésie. Peut-être à cause de cette modestie chevillée au corps de tous les Berbères. Pas toujours, il faut le dire et le répéter, de bon aloi.
Par ailleurs, comment peut-il expliquer cette frénésie poétique –cinq recueils en peu de temps ? À l’en croire, l’inspiration ne le quitte presque jamais. Tout est prétexte à l’écriture. Parfois le mot le plus simple peut être source d’un jaillissement poétique. « Quelque étonnant que cela puisse être, 90% de mes poèmes me viennent à l’esprit en roulant en voiture. Dès que j’en ai l’occasion, je griffonne tout sur un petit calepin qui m’accompagne tout le temps », souligne-t-il. Et pourquoi la poésie et en kabyle ? La réponse est on en peut plus simple : « Je veux transmettre ma berbérité aux générations futures. »
Quant à la forme traditionnelle du poème berbère qu’il a fait sienne et qu’il a remise au goût du jour, il s’en explique ainsi : « Un poème de neuf vers est non seulement facilement mémorisable, mais aussi ramassé, nerveux, car on va à l’essentiel, sans tourner indéfiniment autour du pot. » Et quid des mots crûs qu’il n’hésite pas à employer dans sa poésie et que certains qualifieraient de choquants ? « Je ne me suis pas exilé au Québec pour m’autocensurer », dit-il en balayant d’un revers de main ce genre de critiques qui, «en oubliant souvent l’essentiel, font une fixation sur les détails ».
Pour conclure, on ne peut ne pas évoquer avec notre poète la solution de la question berbère extrêmement sensible pour les régimes nord africains. Il a d’ailleurs un avis sur le sujet. « Il ne faut pas se nourrir indéfiniment d’illusions. Tant et aussi longtemps que notre langue n’est pas officialisée, notre peuple restera ad vitam aeternam non-reconnu, c’est-à-dire inexistant », tranche-t-il, péremptoire. D’après lui, il faut donc tout faire pour que « notre reconnaissance soit, réellement, officielle et institutionnelle ». Avec bien entendu une démocratisation en bonne et due forme. Ce serait, à coup sûr, le début de la résolution de notre problématique. Même si beaucoup s’inscriraient en faux par rapport à sa vision, seul l’avenir est à même de la confirmer ou de l’infirmer. Wait and see.
|
Commentaire de Sheirine-Sophia (29/06/2008 08:54) :
J'ai lu attentivement la biographie de ce poète que vous avez
l'honneur de connaitre..vie jalonnée d'épreuves, d'intenses
émotions, c'est vrai je partage un peu votre opinion...Les poètes ont
quelque chose à avoir avec le spirituel, le divin..inspirations...et
charisme important sans aucun doute...merci de nous faire partager des
parenthèses lumineuses de votre vie.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Le printemps berbère, 28 ans après…Mon devoir, notre devoir…
01/04/2008 20:05

Martin Luther King avait un rêve. Jugurtha avait un rêve et un devoir. Il n’a pas pu réaliser son rêve, ni accomplir son devoir. Ses descendants, qu’ils parlent sa langue ou pas aujourd’hui, ils ont tous et toutes le devoir de le faire. Personne ne le fera à leur place.
La cause du peuple amazigh dans toute l’Afrique du Nord continue à patauger et à subir toutes les politiques d’assimilation. Elle est réduite au folklore le plus malsain en Algérie, à tyrannie la plus cruelle au Maroc et en Lybie, à l’indifférence la plus inexplicable en Tunisie. Qui en est responsable? La réponse facile et rituelle serait celle qui incomberait toute la responsabilité aux pouvoirs politiques en place. Loin de moi l’idée de réduire la part de responsabilité de ces derniers dans l’ampleur des dégâts infligés à cette identité millénaire nord-africaine, mais, il arrive un moment où le Berbère doit se regarder dans un miroir et se dire certaines vérités. Celles-ci lui feraient certainement très mal mais il doit les affronter s’il veut aller de l’avant et réhabiliter l’héritage que ses ancêtres avaient chéri pendant des millénaires contre vents et marrés.
28 ans après le printemps berbère de 80, Tamazight n’a pas encore son statut officiel dans la constitution algérienne. 28 ans après le printemps de 80, l’Algérie n’a pas encore une chaîne de télévision d’expression amazighe. 28 ans après le printemps de 80, l’enseignement de Tamazight est encore optionnel et le statut de l’enseignant de tamazight est encore précaire voire folklorique. 28 ans après le printemps de 80, des millions de Berbères algériens attendent encore qu’une poignée de personnes se sacrifient encore leur jeunesse et leur vie pour arracher d’autres acquis. Et eux, que font-ils entre-temps? Leur arrive-t-il de se sentir interpelés par cette cause qui est censée être la leur aussi? Leur arrive-t-il de se questionner sur leur apport et leur contribution à cette cause et à cette culture?
Les réponses à ces questions seraient multiples et relatives à la situation de tout un chacun.
La première catégorie de Berbères dirait que les politiciens l’ont trahie, alors, elle se retire complètement de l’espace public laissant ainsi le champ libre à l’anarchie la plus totale qui fait l’affaire du pouvoir et de ses valets. La classe politique berbère, loin d’être homogène dans ses perspectives, a elle aussi commis des erreurs. Elle a même relégué tamazight au dernier plan pour pouvoir concrétiser d’abord son objectif partisan. Ce jeu politicien et machiavélique a non seulement nui à Tamazight mais au processus démocratique de la nouvelle Algérie. Un leader politique qui s’éloigne des aspirations de son peuple ou qui ajuste sa ligne politique au gré des conjonctures tracées dans la plupart du temps par le pouvoir ne pourrait obtenir gain de cause à long terme. Il suffit de revisiter les combats de Luther King aux États-Unis d’Amérique contre la discrimination raciale, de Nelson Mandela en Afrique du Sud contre l’apartheid, de Gandhi en Inde contre les Anglais et la violence, pour se rendre compte qu’un idéal a besoin d’une ligne conductrice stable, cohérente et constante, en plus des sacrifices suprêmes que cela exigerait de ceux et de celles qui porteraient cette lourde responsabilité devant l’histoire.
La deuxième catégorie, quant elle, serait persuadée que Tamazight ne donne pas à manger. Alors, elle se rive vers d’autres langues et cultures pour s’assurer un statut social et matériel confortable. Cette population qui pense d’abord à son estomac et à son confort matériel n’est pas moins responsable du chaos dans lequel se démène la cause amazighe. Elle est passive, donc, responsable d’une partie des échecs des tentatives de réhabilitation de Tamazight. Car, ce qui différencie les humains des autres êtres vivants est surtout l’esprit et la conscience. Ces personnes se font vraiment faire croire qu’elles peuvent vivre et ne pas se pas concernées par le sort de leur communauté. Ce qui serait une grave erreur envers elles-mêmes, envers l’histoire et surtout envers leurs propres enfants. Des qu’elles élèvent dans un déracinement total. C’est un fait aussi, un être humain sans repère et sans racine finit par devenir soit, un danger pour les autres ou une loque humaine sans âme.
La troisième catégorie aurait opté pour la voie radicale, voire facile. Elle aurait carrément coupé le pont qui la lie à son identité, épousant sans regret l’identité de l’Autre. Oublions consciemment ou inconsciemment que cet Autre a travaillé très fort pour asseoir son identité et la servir. Cette catégorie est hantée par le fait de travailler sans cesse pour devenir l’Autre et lui plaire au lieu d’entretenir ce qu’elle est d’abord et pourquoi pas vivre en harmonie dans et avec la différence ensuite. Cet état relève d’un cas pathologique. Le cas de Michael Jakson est plus que révélateur. Tout son génie est réduit à néant par son obsession de venir un ‘’homme’’ blanc. Il a tellement subi d’opérations chirurgicales que son corps défendant ne peut même pas supporter l’air libre et encore moins la douceur du soleil du printemps. Au lieu d’être l’exemple de succès pour la communauté afro-américaine, il est devenu l’antithèse du combat de Luther King. Pourquoi se ranger du côté des blancs en changeant la couleur de sa peau au lieu de rester tout simplement lui-même à côté des blancs? Le parallèle est un peu fort mais il existe de ces Berbères complexés d’être eux-mêmes.
Et enfin, Il y a cette dernière catégorie solitaire qui continue à travailler dans l’ombre pour produire loin des feux de la rampe. Cette tranche noble de la population berbère, comme elle a compris que la communauté du destin fait défaut aux siens, elle suit le chemin de Mammeri, de Yacine et des centaines d’autres qui ont bâti, sans soutien, la base de l’édifice que Tamazight a aujourd’hui. Ces fourmis de la mémoire berbère existent en Algérie, au Maroc, en Lybie, en Tunisie, aux Îles Canarie, en Europe et en Amérique du Nord. Ces gens dévoués et désintéressés ont écrit des livres, réalisé des recherches linguistiques, sociales et anthropologiques, réalisé des films, adapté ou écrit des pièces de théâtre, conçu des sites rassembleurs pour mettre en évidence les talents des créateurs, créé des ateliers pour éduquer la relève. Cependant, tous ces efforts ne sont pas suffisants si tous les Berbères ne s’y impliquent pas.
Donc, il est temps pour chaque Berbère de se sentir concerné par le destin commun. Il est temps pour lui de cesser d’étouffer la voix qui l’interpelle pour assurer le bien-être et l’épanouissement de son identité d’abord et de contribuer à l’édification d’une société humaine équilibrée ensuite. C’est notre devoir à tous et à toutes de retrousser les manches pour servir ce que nous sommes et ce, loin de toutes formes de violence ou du rejet de l’Autre. Et l’étoile de Jugurtha ne fera qu’illuminer cette terre nord-africaine que nos ancêtres avaient tellement chérie. Encore, faut-il la trouver et la montrer à nos enfants!
Source : http://www.ksari.com/_portail/index.php?option=com_content&view=article&id=56:printempsberbere&catid=33:opinion
|
Commentaire de Maberouk / casanova (03/04/2008 12:00) :
azul cher ami AREZKI
 Je passe te souhaiter une belle journée ensoleiller pleins de jolies choses
amicalement
Je passe te souhaiter une belle journée ensoleiller pleins de jolies choses
amicalement

http://casanova.mon-vip.com
|
|
Commentaire de Maberouk / casanova (05/04/2008 13:45) :
Coucou cher AREZKI je passe te souhaiter une bonne journée
 Et un bon week-end avec tout amitié
Et un bon week-end avec tout amitié

|
| |
|
|
|
|
|
|
|
MAK, la campagne de sensibilisation des kabyles continue.
31/03/2008 02:59

Le MAK, dont la structuration s’intensifie, multiplie ses activités, son infatigable président, Ferhat Mehenni en tête. Bientôt sept ans depuis sa création et moins de six mois après son congrès constitutif, le MAK gagne chaque jour du terrain dans son combat pour l’autonomie de la Kabylie.
Visites :
 Les 11 et 12 février 2008, Ferhat Mehenni s’est rendu à la commune de Yatafen où il a rencontré les villageois d’Ath-Ddawed, d’Ath-Saada et de Tighzert. Les 11 et 12 février 2008, Ferhat Mehenni s’est rendu à la commune de Yatafen où il a rencontré les villageois d’Ath-Ddawed, d’Ath-Saada et de Tighzert.
 Ensuite, il a été reçu par les villageois de la commune de Tasaft où il a rendu visite aux parents de feu son ami, Mustapha Bacha. Ferhat Mehenni a également rencontré l’écrivain Chabane Ouahioune avec lequel il s’est entretenu pendant plus d’une heure. Ensuite, il a été reçu par les villageois de la commune de Tasaft où il a rendu visite aux parents de feu son ami, Mustapha Bacha. Ferhat Mehenni a également rencontré l’écrivain Chabane Ouahioune avec lequel il s’est entretenu pendant plus d’une heure.
 Après cette entrevue, le président du MAK s’est rendu au cimetière d’Ath-Rvah pour se recueillir devant la tombe du géant de la culture kabyle, Muhend U Yehia. Après cette entrevue, le président du MAK s’est rendu au cimetière d’Ath-Rvah pour se recueillir devant la tombe du géant de la culture kabyle, Muhend U Yehia.
Conférence :
 Une semaine après, Ferhat Mehenni a eu l’agréable surprise que la génération actuelle d’étudiants n’a rien à envier à celle de 80, et cela à Tuvirett. En effet, les étudiants de l’Université de Tuvirett (que Ferhat qualifie de « jeunesse assoiffée de liberté et pétrie de valeurs qui fondent une nation ») ont pu imposer la tenue d’une conférence triomphale animée par le président du MAK. Il faut dire que le rectorat avait refusé cette conférence qui est la première depuis la création de cette université en 2001. Une semaine après, Ferhat Mehenni a eu l’agréable surprise que la génération actuelle d’étudiants n’a rien à envier à celle de 80, et cela à Tuvirett. En effet, les étudiants de l’Université de Tuvirett (que Ferhat qualifie de « jeunesse assoiffée de liberté et pétrie de valeurs qui fondent une nation ») ont pu imposer la tenue d’une conférence triomphale animée par le président du MAK. Il faut dire que le rectorat avait refusé cette conférence qui est la première depuis la création de cette université en 2001.
Kamel SOUAMI
Source : http://www.afrique-du-nord.com/article.php3?id_article=1081
| |
|
|
|
|
|
|
|
Tassaft Ouguemoune :Commémoration de la mort des colonels Amirouche et Haoues
29/03/2008 19:34

Histoire : fondation de l’avenir...
Le village de Tassaft Ouguemoun qui a vu naître le colonel Amirouche n’arrivait pas à contenir la foule qui l’avait occupé l’espace d’une demi journée.
La commémoration du 49eme anniversaire de la disparition d’Amirouche et de Haoues avait une charge particulière.
Est-ce l’imminence de l’interpellation du gouvernement par Nourdine Ait Hamouda à l’Assemblée nationale sur la séquestration des dépouilles des deux héros de la guerre de libération nationale par Boumediene ?
Est-ce la proximité du 50eme anniversaire de la disparition des deux officiers de l’ALN dont on attend de nouveaux témoignages écrits et, selon de bonnes sources, des informations inédites?
Ce regain d’intérêt pour l’histoire récente exprime t-il une demande plus générale d’un peuple qui veut voir son patrimoine historique réhabilité et protégé des censures et des manipulations ?
Il y a certainement un peu de tout cela.
Le fait est que les compagnons du chahid de la wilaya 3 étaient tous là. Les vielles combattantes qui ont eu à croiser Amirouche étaient aussi au rendez vous. Mais chose plus inhabituelle, les jeunes du tissu associatif comme les universitaires ont tenu à communier avec leurs aînés.
Après avoir salué la foule et tenu à rassurer les Algériens sur sa détermination à continuer son combat pour le respect et la protection de la mémoire des martyrs, le fils du colonel Amirouche passera la parole au responsable des moudjahiddines de la wilaya qui fut l’un des plus jeune officiers de l’ALN.
Dans une courte allocution chargée d’émotion, il rappellera le statut exceptionnel du colonel Amirouche : « c’est lourd de parler de Amirouche ou de Haoues. Quand on a vu leur volonté et leur énergie, on comprend mieux leur combat. Amirouche a structuré sa région comme un vrai dirigeant qui a non seulement organisé son territoire mais aidé les autres wilaya. C’est grâce à des hommes comme Amirouche que l’Algérie est devenue une nation libre. Nous devons toujours savoir que ces hommes avaient un courage et une vision qui ont survécu à leur mort. Pour nous, leur disparition physique n’avait pas réduit notre engagement. Amirouche était mort mais son souvenir continuait à animer nos rangs. Il faut que les jeunes se souviennent de tout cela. »
Invité à prendre la parole, le président de l’APW de Tizi-ouzou Mohand Ikharbane délivrera dans un kabyle châtié un message de fidélité et d’espoir : « Amirouche et Haoues nous ont permis de nous retrouver ici dans la dignité et l’honneur. Nous leur devons notre statut d’hommes libres et nous sommes mis en demeure d’honorer leur combat en restant fidèles à leurs serments. La population qui a souffert et qui est encore bien souvent abandonnée attend de nous efforts et sacrifices pour soulager son quotidien. Je pense notamment à tous ces villages qui ont répondu à l’appel de la patrie et soutenu avec un dévouement exemplaire Amirouche et ses pairs. Le colonel Amirouche a fait de la wilaya 3 une région modèle. En tant que responsable de l’Assemblée de wilaya, je peux assurer en ce jour symbolique tous nos concitoyens que notre seul et unique objectif c’est d’accomplir notre mandat avec le même engagement que celui dont a fait preuve le colonel Amirouche pendant la guerre. Comme lui, qui a mobilisé et organisé le plus grand nombre, je réaffirme devant vous que nous resterons ouverts et disponibles pour accueillir toutes celles et tous ceux qui ont comme souci le bien être de la collectivité.
La seule frontière que nous mettrons à notre action est celle qui sépare l’honneur de la trahison ou l’intégrité de la corruption. »
Le colonel Bouzeghoub, membre du Conseil de la nation témoignera en tant que secrétaire de la wilaya 1 qui a vu le colonel Amirouche intervenir dans les Aurès pour remettre en ordre de bataille une région minée par les conflits internes après la disparition du chahid Benboulaid. Jeune maquisard ayant rejoint les rangs de l’ALN après la grève, M.T. Bouzeghoub apportera un double témoignage en évoquant le soutien financier envoyé par Amirouche pour la wilaya 1 afin de prendre en charge les soldes des moudjahiddines et les pensions des veuves de chahids.
Sur un autre registre, il donnera un éclairage sur le souci permanent d’Amirouche de veiller sur les jeunes cadres en les envoyant à l’étranger pour former les responsables de l’Algérie indépendante. «C’est parce que le colonel Amirouche pensait à l’avenir de
la Nation que j’ai pu faire mes études dans une académie militaire et devenir pilote. C’est aussi grâce à lui que je suis aujourd’hui vivant pour vous apporter ce témoignage.
N’oubliez pas une autre chose essentielle : Amirouche n’a pas seulement donné à sa wilaya un potentiel militaire qui a fait face à l’ennemi ; son envergure a était utile à de nombreuses autres wilayas.»
Said Sadi durant sa prise de parole
Intervenant en dernier, Said SADI, dira d’entrée :
« l’histoire est à la nation ce que la fondation est à la maison. Nous sommes aujourd’hui dans un cimetière, nous devons à nos héros respect et devoir de vérité. Sans faire de procès d’intention, il nous faut entreprendre, dans l’urgence, la préservation et la réhabilitation de ce patrimoine commun d’une valeur symbolique et politique exceptionnelle, capital sans lequel aucun peuple ne peut avancer.
Je reviens des Etats-Unis dont la nation moderne a à peine deux siècles et demi d’existence. Le moindre acte, le moindre propos, le moindre site est répertorié et valorisé. Avec des événements ordinaires et sur une période courte, les Américains ont structuré leur mémoire en tant que fondement de leur projet national.
Nous sommes assis sur 3000 ans d’histoire ; nous n’assumons rien. Pire, quand nous ne censurons pas, nous déformons.
Toutes les révolutions ont eu leurs travers. Pour ne rester que dans le cas de
la Kabylie, les pertes et les abus sont terrifiants.
Dans la pression de la guerre, le mouvement de libération algérien a lui aussi connu ses égarements. La semaine passée, la commune de Mekla a réhabilité Ouali Bennai, géant parmi les géants du mouvement national. Dans ce village qui nous accueille, Amar Ould Hammouda a été exécuté par ses frères de combat. Il en fut de même de Mbarek Ait Menguelet, autre héros dont le fils est présent parmi nous. Abane Ramdane, l’architecte de la guerre de libération fut assassiné par ses pairs. Nous ne sommes pas là pour juger ce qui c’est passé dans une guerre sans merci, mais nous devons connaître la vérité pour assumer notre passé, tout notre passé afin de prémunir les générations montantes de pareilles épreuves.
Mais ces pertes inestimables ont connu des rebonds inadmissibles après l’indépendance. Abane a subi des attaques indignes dans l’Algérie d’après guerre. Comme si sa mort physique ne suffisait pas et qu’il fallait une deuxième fois l’enterrer symboliquement.
Krim Belkacem qui a échappé à l’armada française a été tué en Allemagne parce qu’il voulait donner son avis sur la gestion d’un pays dont il fut un libérateur émérite.
Que dire alors du mal absolu : la séquestration des dépouilles mortelles d’Amirouche et Haoues pendant 20 ans pour les soustraire au souvenir et à la reconnaissance de leur peuple.
Aucune autorité, aucun pouvoir, aucune raison d’Etat ne peut justifier de tels forfaits.
Il y a de quoi être pessimiste quand on voit ce qu’a commis le pouvoir algérien contre d’authentiques héros de la nation.
Mais quand on observe, d’un autre coté, les initiatives se multiplier autour des cérémonies consacrant la grandeur et les vertus de ces hommes repères et qu’elles émanent de citoyens souvent jeunes, on est en droit de se dire que la demande de vérité est plus forte que toutes les manœuvres.
Plus le pouvoir essaye de faire oublier ou de souiller la mémoire de ces martyrs, plus les jeunes s’y intéressent et les honorent.
Plus on essaye d’attenter au charisme du colonel Amirouche, plus il habite les cœurs.
Comme tous les enfants de la guerre j’en ai un souvenir inouï. Cet homme était rentré dans la légende de son vivant. Les femmes de nos montagnes le célébraient par des poèmes avant même qu’il y ait quitté le village qui l’accueillait. J’ai dans ma mémoire d’enfant des bribes de phrases de soldats français qui l’évoquaient dans un mélange de haine et de respect.
Mais ce n’est pas sur les compétences militaires d’Amirouche que je m’attarderai aujourd’hui. Je voudrais alerter nos jeunes sur deux qualités relativement peu connues du personnage car des dirigeants se sont employés à les réduire ou les souiller.
La première c’est la dimension politique du colonel Amirouche. Le témoignage de M.Bouzeghoub vient de nous en dévoiler une partie. Amirouche n’était pas seulement un baroudeur, il était un dirigeant qui avait façonné son organisation de sorte à prendre en charge les problèmes sociaux d’une population opprimée. Son administration était d’une performance qu’on voudrait bien retrouver dans celle d’aujourd’hui : pensions livrées dans les délais, assistance sociale quasiment généralisée, système de santé conséquent pour les troupes et couvrant une part non négligeable des besoins de la population.
Mais au-delà, c’est la vision de l’après guerre du colonel Amirouche qu’il nous appartient de valoriser. Formation des cadres pour l’Algérie indépendante, lutte sans merci contre les oligarchies claniques et le régionalisme ont été des préoccupations de tous les instants chez cet homme visionnaire.
Il faudra regrouper et recouper les témoignages des officiers qui ont assisté à la dernière réunion qu’il a tenu en wilaya 3. Tout en les assurant que l’Algérie sera indépendante, Amirouche exhortait ses collaborateurs à rester vigilant.
L’essentiel des motivations de la mission qui devait le conduire à Tunis et dont il ne reviendra jamais était d’ordre politique et non logistique comme on a voulu le faire croire.
La deuxième qualité sur laquelle il faudra se pencher est la dimension humaine que ceux qui ont suivi Amirouche ont pu apprécier. Je m’en tiendrais, pour aujourd’hui, au propos du docteur Laliam qui fut le médecin d’Amirouche en wilaya 3. Agé de 80 ans, il me faisait cette confidence hier soir : j’étais jeune médecin bien établi à Tunis jusqu’au jour ou Amirouche qui y passait vient me voir. Je l’avais connu à Relizane. J’ai décidé de rentrer avec lui autant pour des raisons politiques que personnelles. Il était droit, il était juste, il était sain. On avait envie de lui faire confiance. Du jour au lendemain, j’abandonnai une situation toute faite en Tunisie pour me retrouver quelques semaines plus tard dans les massifs de l’Akfadou. Je l’ai suivi d’abord et avant tout parce que c’était lui.
Pour finir, mes chers frères, nous devons aussi être des chercheurs de vérité dans le passé si on veut sauver notre pays.
En tant qu’élus nous ferons tout pour que les institutions évoluent et s’amendent de fautes qui ne doivent plus se reproduire et que l’on ne peut pas imputer à l’ennemi. En tant que citoyens vous nous trouverez toujours à vos cotés pour reconstruire et protéger la mémoire de notre peuple. »
Source: http://www.rcd-algerie.org/index.php?id_rubrique=167&id_article=841
| |
|
|
|
|
|
|
|
Algorithme Pharma : Plus de 25 000$ pour combattre le cancer!
01/03/2008 05:24

Plus de 25 000$ pour combattre le cancer!
Pendant toute l’année 2007, les employés d’Algorithme Pharma ont fait leur part pour eradiquer cette sombre maladie qui touche plus d’un canadien sur trois.
Un comité a été formé parmi les employés de cette entreprise afin de trouver des moyens originaux d’amasser des fonds. Avec de multiples campagnes de financements, dont une vente de gâteaux, un bazar, un party d’halloween, des déductions à la source, des ‘’journées jeans’’ et plus de 50 marcheurs au Relais pour la Vie en juin 2007, ils ont amassé 25 250$ qui ont été remis à la Société Canadienne du Cancer en ce 28 février 2008, pour servir à la recherche contre le cancer et le soutien aux victimes.
Sur la photo : Éric Poirier, Cindy Ospedale, Natasha Savoie, Virginie Leclaire, Claude Tremblay, Jocelyne Bruneau, Annick Cormier, Isabelle Dubois, Arezki Ait-Ouahioune et Louis Caillé, président d’Algorithme Pharma.
More than $25,000 to fight against cancer!
During the year 2007, Algorithme Pharma’s employees did their part to eradicate this disease who touch more than one canadian out of three.
A committee was formed amongst the employees in order to find original ways to collect money. With multiples financing campaigns such as a bake sale, a bazaar, halloween party, pay deductions, jeans days and more than 50 walkers at the June 2007 Relay for Life, they accumulated $25,250 which was given to the Canadian Cancer Society on February 28, to support cancer research and help the victims.
On the picture : Éric Poirier, Cindy Ospedale, Natasha Savoie, Virginie Leclaire, Claude Tremblay, Jocelyne Bruneau, Annick Cormier, Isabelle Dubois, Arezki Ait-Ouahioune and Louis Caillé, Algorithme Pharma president.
http://www.algorithmepharma.com/
| |
|
|
|
|
|
|
|
La Numérotation téléphonique à 10 chiffres pour les téléphones mobiles en Algérie est opérationnelle depuis le 22 février.
26/02/2008 18:38
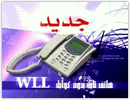
Azul ,Bonjour,
Un rappel que la Numérotation téléphonique à 10 chiffres pour les téléphones mobiles en Algérie est opérationnelle depuis le 22 février.
Pour en savoir plus, consulter http://www.algerietelecom.dz/
Cordialement,
Arezki Ait-Ouahioune
| |
|
|
|
|
|
|
|
3ème Vol hebdomadaire d’Air Algérie sur Montréal en été.
24/02/2008 01:05

Liaison aérienne entre l’Algérie et le Canada: Un troisième vol hebdomadaire à partir de juin.
Air Algérie prévoit de renforcer sa ligne Alger-Montréal par un troisième vol hebdomadaire, le dimanche, en plus de ceux de mardi et vendredi. L’information donnée par le site algeroweb.com a été confirmée à El Watan par une source de la compagnie nationale à Montréal.
La compagnie vient d’introduire une demande auprès de l’Office des transports du Canada pour augmenter le nombre de ses vols hebdomadaires. Le vol du dimanche sera aligné sur la même plage horaire actuelle et concernera la haute saison, soit du 29 juin au 27 septembre. Vu le succès et le taux de remplissage de cette ligne pendant l’été 2007, Air Algérie veut récupérer tous ceux qui sont obligés de recourir aux services de la Royal Air Maroc et d’Air France et à une moindre mesure Air Canada en passant par Francfort sur les avions de la Lufthansa. Pour la haute saison, Air Algérie estime que ses tarifs seront concurrentiels. Ils se situeront entre 1250 et 1700 dollars canadiens taxes incluses pour des billets valables six mois. La franchise bagages, quant à elle, est maintenue à 2x32 kg. Au niveau des agences de voyages, l’information a été accueillie avec « bonheur ». On affirme que les réservations pour l’été ont commencé bien avant le début de l’année en cours. Les premiers arrivés ont bien sûr bénéficié des plus bas tarifs de l’offre actuelle. Les voyagistes de Montréal espèrent qu’avec le rajout du vol du dimanche d’autres passagers pourraient bénéficier des tarifs à 1250 dollars canadiens taxes incluses. Actuellement, Air Algérie applique des tarifs spéciaux de près de 940 dollars canadiens valables deux mois pour un départ avant le 1er avril. Air Algérie dessert Montréal par un vol direct depuis le 15 juin 2007 à raison de deux vols hebdomadaires : le mardi et le vendredi. La durée du vol est de 8h55 dans le sens Alger-Montréal et de 7h40 dans le sens Montréal-Alger. A noter aussi la présence sur le système de réservation en ligne d’Air Algérie de la desserte de New York. Une destination que nous n’avons pas pu confirmer auprès d’Air Algérie.
Par Samir Ben Djafar (Montréal, Correspondant)
Source : http://www.elwatan.com/spip.php?page=article&id_article=86529
|
Commentaire de SOLEILDEVIE (27/02/2008 15:16) :
 Tout succès débute par un "rêve"
J'ai pensé que t'envoyer
Un peu de"rêve"
T'aiderai à passer
Une merveilleuse semaine
Amitié
MARTINE ( j'ai mon meilleur ami qui habite en kabylie,je lui ai fait
un blog sur nrj que pour lui et son merveilleux pays ,et sur mon vip je
parle de lui )
Tout succès débute par un "rêve"
J'ai pensé que t'envoyer
Un peu de"rêve"
T'aiderai à passer
Une merveilleuse semaine
Amitié
MARTINE ( j'ai mon meilleur ami qui habite en kabylie,je lui ai fait
un blog sur nrj que pour lui et son merveilleux pays ,et sur mon vip je
parle de lui )
|
| |
|
|
|
|