|
|
[ Sports/Kabylie ] [ Photos ] [ Famille ] [ Sports/Algérie ] [ Liens/clips/videos ] [ Histoire/Autres ] [ Poésie/Social ] [ Divers ] [ Musique ] [ Culture ] [ Evenements ]
|
|
|
|
JSK, la legende...
12/01/2008 06:07

La J.S.K est officiellement né en 1946, mais en réalité elle est né en 1933, durant l’époque coloniale, la J.S.K dût végéter comme tous les clubs algériens de l’époque...
Dans les années cinquante, l’Olympique de Tizi-Ouzou (un club colonial )occupait le devant de la scène grâce à ses ressources financières et ses nombreux privilège administratifs en temps que club colon. Comme tous les clubs algériens, la J.S.K cessa toute activité pendant la guerre d’Indépendance (1954-1962) et ne ressuscita qu’en 1962 à la fin de la guerre dans le premier critérium organisé en 1963. La J.S.K occupa longtemps la place de leader de son groupe avant de se faire coiffé lors de la dernière journée par le M.C.A .
Ensuite, malgré Terzi, Zeghdoud, Khalfi, Haouchine, la J.S.K végéta pendant plusieurs saisons en Division d’Honneur avec le W.A.Boufarik, U.S.M.Maison Carré, l’O.M.Ruisseau...
La J.S.K accéda en National I lors de la saison 67/1968, sous la houlette d’un entraîneur de renom : le regretté Ali Benfadah, un ancien joueur de la grande équipe F.L.N. Sur sa lancée, elle fit un bref passage en National II, puisqu’elle accéda en National I en 68/1969, sous la direction du Français Jean Lemaître (69/1970), puis du regretté Abdelaziz Ben Tifour (70/71) remplacé après son décès accidentel par Abderahamane Boubekeur, c’est à ce moment là que la J.S.K devint le porte drapeau et le symbole de toute une région, d’ailleurs l’équipe joue en jaune et vert qui sont les couleurs de l’Amazighité. En 1973, l’équipe de Tizi-Ouzou ( la ville des Genêts), obtenait son premier titre de champion, c’était le début d’une suprématie totale, en quelques années, la J.S.K s’imposait comme leader du foot algérien. Pour ses milliers de fans, il est le représentant d’une revendication identitaire, longtemps étouffée, des idées fortement exprimées à domicile, mais aussi le 19 juin 1977, à Alger, à l’occasion de la final de la coupe d’Algérie, gagnée 2-1 contre le N.A.Hussein Day, ce jour là et pour la première fois loin de stade, les supporters KABYLES bravent l’interdit en clamant haut et fort leur Amazighité devant tous les dignitaires du régime, suite à cela le pouvoir décida de révisé le nom du club en Jeunesse Sportive Kawkabi (1977-1978) puis ensuite en Jeunesse Électronique de Tizi-Ouzou (J.E.T, 1978-1990). Se remémorant cette époque, un ancien joueur kabyle confiait : "En 1977, à l’occasion de la célébration de notre doublé, après avoir rencontré la crème de la Kabylie, chanteurs, sportifs, hommes de lettres et de culture, nous avons compris que nous étions investis d’une mission : celle de représenter dignement cette région ."
L’éclosion du "Printemps Berbère" en avril 1980 et du "Printemps Noir" en avril 2001, avec leurs cortèges de revendications politique, culturelles, indentitaire et linguistique, on donna une autre dimension à la J.S.K. et les sphères du football, mais aussi celle du pouvoir, s’accommodèrent très mal de la réussite de ce club, à chaque déplacement, les joueurs, dirigeants et supporters faisaient l’objet d’insultes ( on les traitaient de : paysans des montagnes ) et de menaces, accusés à travers la J.S.K., de chercher à diviser le pays. Aujourd’hui l’hostilité envers ce club pas comme les autres s’est atténuée, à défaut d’avoir totalement disparut.
 Toute fois le foot Kabyle ne se résume pas seulement à la J.S.K., il peut aussi compter sur la J.S.M.Béjaïa et beaucoup d’autres dans les divisions inférieurs. Historiquement le 1er club Kabyle à voir le jour est la Société Sportive de Sidi-Aïch (S.S.S.A) en 1921, deux ans plus tard c’est la Rachidia, le 1er club de Bgayet (Béjaïa) ancêtre de l’actuelle Jeunesse Sportive Musulmane de Bgayet.
Source : http://www.tamurth.net/article.php3 ?id_article=556
| |
|
|
|
|
|
|
|
Yennayer ou le souverain des mois.
12/01/2008 04:14
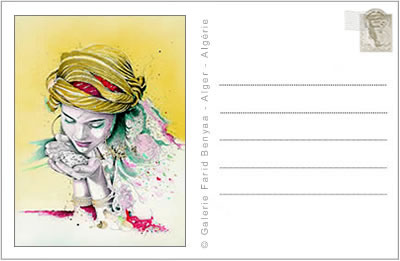
"Avertissement : je ne parlerai pas ici de « considérations extérieures que d’aucuns spécialistes ont développées ici et là à propos de yennayer en partant d’un certain dieu Janus ». Je ne parle ici que de simples choses et faits : « Yennayer de la mère kabyle » en révélant « le visage interne de Yennayer » (udem n Yennayer ) tel que les mères et les grand-mères kabyles se le représentaient et le fêtaient autrefois. Ce fut l’une des manifestations les plus importantes de la cité kabyle." Youcef Allioui
Yennayer est un mois composé qui signifie « premier mois » (yen/ayer). Le premier jour de yennayer correspond aussi aux « premières portes de l’année » (tiggura timenza useggwas), par opposition aux « portes de l’année de l’automne » (tiggura useggwas iweooiben). Yennayer le dit bien aux autres mois qu’il surprit en pleines médisances à son sujet : - « C’est moi qui ouvre les portes de l’année « (d nekk i-gpellin tiggura useggwas). Le dicton dit : « Le roi des mois, c’est yennayer » (agellid n wagguren d yennayer). « Un jour Yennayer surprit les autres mois en train de dire du mal de lui : « Janvier le bruyant poussiéreux, c’est depuis toujours qu’il est comme ça ! » (yennayer à bu-lêrka, ansi yekka ttebâit takka si zzman n jeddi-s akka !) Il leur rétorqua : « Si je la laisse tomber, la relève qui veut ! Si je la relève, la rabaisse qui veut ! » (ma sres$-as wa’b$a yrefd-ip ! ma refde$-p wa’b$a ysers-ip ! ».
On connaît le mythe de la vieille aux moult versions qui, voyant Yennayer s’en aller au bout de son trentième jour, osa le défier en lui disant qu’il était fort seulement en paroles ! « Oncle Yennayer, quelle insignifiance tu traînes derrière toi ! Tu es parti sans avoir rien accompli ! » (Gezggeî a Eemmi Yennayer ! Tôuêev ur texdimev kra !) Mal lui en prit à la vieille, Yennayer la tua elle et sa chèvre dans la journée qu’il avait empruntée à février (Fuôar). Dès qu’il entendit les moqueries de la vieille, il s’en alla voir Fuôar et lui dit : « Je t’en prie oncle Fuôar, prête-moi une seule journée qui restera dans les mémoires : je rendrai gorge à la vieille insolente ! » (Pxil-ek a Eemmi Fuôar, ôevl-iyi yiwen si wussan n nnbaô ; a d-rre$ ppaô di tem$art m-lemôaô !)
Depuis, la dernière journée de Yennayer s’appelle « l’emprunt » (ameôvil). La mythologie nous a également gratifié de « poèmes de yennayer » (isefra n yennayer) et de « chants de Yennayer » (ccna n Yennayer). C’est dire toute l’importance que ce mois de Yennayer revêt aux yeux des Kabyles.
Il est d’usage que nous commencions par le commencement, c’est-à-dire par la fête du « premier de yennayer » (amenzu n yennayer), du 12 au 14 janvier du calendrier grégorien selon les années. Selon les anciens, cette date pouvait varier d’un district à un autre de la Kabylie (Tamawaya), voire d’une région à une autre de la Berbérie (Tamazgha).
Cette fête est appelée la « fête de fin d’année » (tame*ôa n yixf useggwas). A l’origine, la fête durait 7 jours. La première journée était chômée. Quiconque enfreignait l’interdit risquait la stérilité. L’immolation du mouton ou du bélier était un sacrifice rituel offert la Terre - mère nourricière - pour obtenir d’elle une année agricole féconde, fertile, tranquille et prospère. Le dicton dit « Yennayer fait la bonne récolte » (Yennayer d ûûaba). Sentiment profond car, selon mon grand-père, l’année agricole - marquée par un calendrier rigoureux - possède un cycle biologique semblable à celui de l’Arbre, de l’Animal, de l’Oiseau et de l’Homme.
Yennayer était l’une des plus grandes fêtes berbères. Ce premier jour de l’an berbère correspond à ce qui est appelé dans le calendrier berbère solaire le « premier jour des froids blancs » (yiwen g-semmaven imellalen). Ce jour-là correspond également, à peu de choses près, à ce qui est permis d’appeler le « jour de la femme » ou, plus exactement, « le jour de l’Assemblée des femmes » (Ass n Wegraw n tlawin). Une journée bien lointaine où les femmes fêtaient les grands froids de janvier. Nous avons vu que la mythologie kabyle attribue bon nombre de défauts, voire de tares et de catastrophes à notre vieille grand-mère. On lui doit notamment l’immobilité et le mutisme des choses de ce monde. Mais, on lui doit donc aussi le courroux de Yennayer, dont nous sommes en train de parler et dont les femmes kabyles fêtent si bien encore la venue . Mais il est très rare que les petits enfants kabyles, qui ont connu leur grand-mère, trouvent celle-ci mauvaise et acariâtre. On ne peut pas dire d’une vieille femme kabyle qui, pendant les longues soirées d’hiver, captive par sa parole une nombreuse assistance qu’elle n’est pas écoutée ou « qu’elle n’est pas valorisée par sa sagesse », comme d’aucuns l’ont écrit ici et là. Le dicton est clair : « Une maison sans vieille est pareille à une figuerie sans caprifiguier, sans figuier mâle » (axxam mebla tam*aôt am urti mebla tadekkwaôt). Yennayer avait dit aux Anciens Kabyles : « De mon début jusqu’à ma fin, je vous ferai voir de toutes les couleurs, mais, comme vous êtes parmi les peuples premiers, je vous apporterai bonheur et bonnes récoltes ! » (seg-semmaven a l*ezla a-wen seôwu$ imeô$an ; d-acu kan, mi tellan seg’Mezwura, awen-d awi$ lahcaca, a-wen-d rnu$ l$ella !).
Selon ma grand-mère Ferroudja, ce fut une jeune fille sagace qui avait promis d’offrir à Yennayer des crêpes dès le matin de son premier jour et un bon souper pour le soir s’il se montrait plus conciliant avec les pauvres montagnards ! Yennayer lui répondit : « J’accepte avec une offrande choisie, les ustensiles pleins de nourritures, les crêpes et le couscous sans oublier la part de l’absent » (pmadi* s-usfel meqqwren, p-paççaôt l_leêwal, p-pe$ôifin d seksu, d umudd g_gwin inagen).
Depuis, on immole une bête comme offrande dont la viande garnit le couscous du souper de yennayer (imensi n yennayer). On prépare les crêpes (ti$rifin) et beaucoup d’autres gâteaux pour le petit déjeuner. Au retour de la fontaine, les femmes déposaient dans la cour de l’Assemblée les gâteaux qu’elles avaient préparés la veille et le matin. Quant au repas du midi, il est composé de gros couscous (berkukes) dont les graines se gonflent au contact du bouillon comme l’on voudrait que le grain enfoui dans la terre - semé - germe et procure une bonne récolte (ûûaba). Les ustensiles devaient être pleins de victuailles : rite d’abondance. Et comme l’exige Yennayer, on mettait un couvert pour chaque membre de la famille absent. On évite les produits épicés et amers et on prépare des mets sucrés comme les crêpes.
Juste avant le souper, le repas qu’ils n’avaient pas pris, était mis à la disposition des pauvres : un plat était porté à l’assemblée. On ira le reprendre tard dans la nuit. Les absents sont aussi souvent des absentes : les filles mariées auxquelles on met toujours de côté la part de viande, de gâteaux et de friandises qui leur reviennent. Tout le monde devait manger à satiété, y compris les vagabonds de passage qui étaient toujours traités avec beaucoup d’égard, mais surtout ce jour-là. Le soir, juste avant le souper, la mère donnait à ses enfants des graines de céréales qu’ils devaient tenir dans la main le temps d’une prière sur la genèse selon la mythologie kabyle : « Il y eut un jour dans l’univers, le Souverain Suprême transforma les ténèbres en lumière ; il sema les étoiles dans le ciel ; Il enleva tout ce qui était néfaste et lava la boue à grand eau !... » (Yella yiwen wass di ddunnit yekker Ugellid Ameqqwran ; îlam yerra-t p-pisrit, deg’genwan izreƒÕ itran ; yekkes kra yella dirit, alluv yurad s waman. Aluv yurad s waman a Bab Igenwan !...) Chacun doit veiller à soigner sa conduite : s’abstenir de prononcer des mots qui fâchent et d’avoir de mauvaises pensées qui offenseraient le Génie-Gardien de la maison. Chacun doit demander pardon à chacun. Comme la fête de Yennayer durait 7 jours, on attendait la journée où la neige « liait » la fédération kabyle (Tamawya) : quand les montagnes des At Wadda (Archs du Djudjura occidental) et des At Oufella (Archs du Djurdjura oriental, vallée de la Soummam, les montagnes des Portes, des Babors et du Guergour) étaient liées par la neige : on sacrifiait le mouton.
La fête de la rencontre des neiges ou le sacrifice de Yennayer
Dans la vallée de la Soummam avait lieu dans les mois de décembre et Yennayer la fête dite « de la rencontre des neiges » (tamyagert g_gwedfel). Quand la neige de l’Akfadou et du Djurdjura rencontre celle de l’Achtoub et de Takintoucht - montagnes des Babors non loin de Tizi Wouchène -, on sacrifie un mouton. Comme l’avait dit Yennayer, la neige est un signe annonciateur d’une très grande et bonne récolte (ûûaba d l*ella). Nous disons alors « elle l’a réunie » (tsemyagr-ip) : c’est-à-dire que la neige a réuni les deux côtés de la Kabylie « sous son burnous blanc ». Autrefois, pendant Yennayer, les Kabyles allumaient de grands feux de joie pour signifier leur bonheur les uns aux autres. La mère kabyle parcourait avec une lampe tous les coins de la maison pour souhaiter le bonheur à tous les membres de la famille y compris les oiseaux et les animaux domestiques . Il était d’usage qu’elle commence par les parents. Elle tendait la lampe dans la direction de chaque Etre en formulant des souhaits de joie : « Soyez heureux mon père et ma mère ! Soyez heureux mon mari ! Soyez heureux mes enfants ! Soyez heureux anges gardiens de la maison ! Soyez heureux bœufs ! etc. (Ferêewt a baba d yemma ! Ferê ay argaz-iw ! Ferêewt a yarraw-iw ! Ferêewt a y iƒÕessasen g-wexxam ! Ferêewt ay izgaren !) Les enfants se roulaient nus dans la neige pour devenir fort et ne pas craindre le froid ! Ils croquaient l’eau de la neige de Yennayer ! Ils faisaient des batailles rangées à coups de boules de neige. Les grands roulaient un amas de neige jusqu’à ce qu’il devienne aussi grand qu’un grand rocher ; alors ils en faisaientt souvent non pas un grand bonhomme de neige ; lequel, en kabyle, s’appelle « l’ânesse » (ta$yult). Ils installaient « l’ânesse » en bas des villages, sur le plateau réservé au jeu (agwni) avant de la décorer pour l’offrir aussi belle que possible à Yennayer.
Dans toutes les cours intérieures des maisons, les plus petits construisaient des bonhommes de neige à leur taille ((ta$yult tamecîuêt). Un jeu consistait aussi à fabriquer une presse à huile dans la neige. Il y avait des périodes où la neige tombait plusieurs jours de suite. Quand, le matin, les gens ouvraient leurs portes, ils tombaient souvent nez à nez avec un mur blanc de neige du sol au toit de la maison. La couche de neige atteignait parfois plusieurs mètres de hauteur. Les hommes du village devaient sortir et, armés de pelles, ils dégageaient les ruelles du village. C’était une entraide collective obligatoire qui consistait à chasser la neige. Elle porte le nom de « cassure de neige » (taruéi usalu ). Asalu est la couche de neige qui ne permet pas aux pieds d’atteindre la terre ferme. Dans une comptine fort ancienne, les enfants chantaient Yennayer qui provoquait Asalu :
Les portes de l’année sont ouvertes Nous les voyons de l’Akfadou Yennayer prend garde que les mottes de neige ne deviennent de l’eau Garde-les biens pour qu’elles s’amoncellent bien haut Nous, nous sommes en train de « casser l’asalu » !
Tiggura igenwan llint Nwala-tent seg’wkeffadu Yennayer êader ak fsint Eass fell-asen ad alint Nekwni nepôué asalu !
A chaque chute de neige, une fois les ruelles dégagées, les enfants parcouraient le village en chantant : « Dieu, donne des flocons de neige, nous mangerons et resterons à ne rien faire, nous donnerons de la paille aux boeufs ! » (A Öebbi fk-ed ameççim, a-neçç a-neqqim, a-nefk i yezgaren alim !). Comme la neige ne leur suffisait pas, ils allaient jusqu’à la rivière qui gelait. Là ils faisaient du « patin sur glace » et de l’escalade le long des conduits des moulins à eau pour cueillir les figurines qui se formaient dans la glace. Ce sont des jours qu’il est difficile d’oublier. Le Djurdjura et l’Akfadou ainsi que l’Achtoub et les autres montagnes kabyles (Tiggura, Ababur, Aguergour) revêtaient leur manteau blanc. Quand Les mères kabyles voulaient chauffer de l’eau, elles remplissaient de neige propre un ustensile avant de le mettre sur le feu.
Les anciens appelaient la neige « la salive du Maître des Cieux » (imetman n Bab Igenwan). Dans notre mythologie, le Souverain Suprême a créé la neige pour permettre au monde de se régénérer, d’avoir une longue vie. L’eau de la neige en s’infiltrant dans la terre « régénère les tissus, les os de celle-ci ». Le jour où il ne neigera plus, où il n’y aura plus de neige, la terre sèchera comme un vieillard. Ses os craqueront et elle mourra. Quand la neige tombe, c’est le Maître des Cieux qui souffle d’un air frais sur la terre ».
Enfin, le soir du souper, les femmes parlaient avec verve et émotion de leur journée. Toutes les portes restaient grandes ouvertes, car ce jour-là était aussi le jour du carnaval, appelé « le vieux sage au tesson » (am$ar uceqquf ). Les gens restaient dehors afin d’accueillir les enfants qui, masqués, parcouraient le village en chantant le premier jour de l’année.
Ô premier jour de l’année, ô portes des cieux ! La neige arrive à la taille, mais elle deviendra de l’eau Ô maison, ô Génie Gardien, nous nous souvenons de ce jour Les ventres sont pleins et les têtes sont joyeuses...
Ay ixf useggwas p-piggura igenwan Adfel ar wammas, ad yefsi d aman Ay axxam d u*essas, necfa f yiwen wass I*ebbav ôwan, iqqweôôay zhan...
Chaque maîtresse de maison leur remettait des oeufs et des gâteaux, en disant ou en chantant : La fin de l’année, c’est le premier jour de l’année Nous nous en souviendrons, nous mangerons de la viande Nous oublierons la farine de gland !
Ixf useggwas, d-amenzu useggwas A-necfu fell-as, a-neôwu aksum ; a-neppu amalas !
Les enfants parcouraient les ruelles du village, derrière l’un d’eux qui personnifiait ce personnage mythique qu’était « le vieux sage au tesson » qui avait juré fidélité à « mère Yennayer » (yemma Yennayer). L’on raconte que le sage appelé « celui qui dit la vérité » (admu t-tidep) habitait une cité où les femmes étaient brimées et où des manquements à la liberté étaient manifeste au vu et au su de l’Assemblée (Agraw). Comme ceux qui tenaient le pouvoir ne voulait pas revenir à un fonctionnement plus juste de leur Assemblée, « Celui qui dit la vérité » finit par leur dire : « Par le serment des gens qui n’ont pas peur de dire la vérité, que je ne resterai plus jamais dans la cité des dictateurs ! » (Aêeqq kra di-wansen, a taddart iwersusen, ur qqime$ ger-asen !) Il quitta sa cité et s’en alla habiter dans un refuge isolé. Il ne prit avec lui qu’un tesson plein de braises pour se chauffer... Depuis, les Kabyles lui rendent hommage à travers un carnaval qui porte son nom « le vieux au tesson » (am$ar uceqquf). A la tombée de la nuit, les enfants grimés et masqués parcouraient les ruelles de la cité. Les gens étaient tenus de laisser leurs portes ouvertes. Les gens devaient se tenir devant leur maison pour accueillir le groupe d’enfants qui devaient lâcher leur sentence-vérité (awal t-tidep) concernant chaque maison. Les mots étaient parfois très crus (c’est pour cela que les enfants étaient masqués : c’était la voix du vieux au tesson qui s’exprimait. Il s’agissait de rétablir la vérité pour laquelle le « vieux au tesson » - appelé aussi « la sentinelle de la vérité » (aweqqaf t-tidep), avait préféré vivre dans l’isolement et la solitude jusqu’à sa mort.
Exemple de sentence (izli) devant les gens où la maison dont la maîtresse était connue pour sa mauvaise conduite et son mauvais caractère.
Un enfant masqué s’avance et dit :
« Voici les paroles du sage au tesson : « Ô Waâli ! Ô Waâli ! Sache que ta femme est bien vilaine ! Elle n’a aucun charme, elle ne dit jamais la vérité ! Elle est avare et sèche comme un vieil oignon ! Elle tient des propos sur d’autres qui sont bien mieux qu’elle ! En vérité, il faut que tu saches qu’elle ressemble au cul du singe ! » ( A-ta wawal n wem$ar uceqquf :A dda Waâli ! A dda Waâli ! Tameîîut-ik d m-xenfuî ! Ur tesai sser, ur tessi tidep ! P-tamecêaêt teqqur am tebselt ! Thedder yal lehdur af widan i-pyifen ! Ma yella teb$iv tidep, tecba taqerqurt ibekki !) Pour se faire pardonner, la maîtresse de maison devait jouer le jeu et offrait des friandises et des oeufs ! Le maître de la maison leur donnait une pièce. Quand ils terminaient la tournée du village, ils se donnaient rendez-vous dans la cours de l’assemblée. Là, l’un d’eux qui occupait les fonctions de chef (amnay) - cela pouvait être un adulte qui faisait partie du carnaval -partageait entre eux le « butin » fait d’oeufs durs, de gâteaux, de friandises et... de quelques pièces d’argent.
Le rituel du carnaval obéissait aussi à une autre Vérité absolue, appelée « le dû de la vie » (azal n tudert) - qui est le principe du vieillissement qui frappe les Hommes et toutes les choses qui l’entourent et qui sont vivantes sur terre. Dès leur plus jeune âge, il faut que les enfants prennent conscience qu’eux aussi vieilliront. De ce fait découle deux règles. La première est expliquée par le dicton : « C’est la jeunesse qui travaille pour la vieillesse » (p-peméi i-gxeddmen af tem$weô). On apprend aux enfants à préparer leurs vieux jours en travaillant, sous peine de se voir réduits à quémander comme le font les vieux qui n’avaient pas assez amassé de biens pour protéger leurs vieux jours. La seconde est le corollaire de toute éducation kabyle : le respect des personnes âgées et ce quelle que soit leur condition : « qu’elles soient à leur printemps ou à leur hiver » (£as llan di tefsut, xas llan di tegrest).
On voit donc que Yennayer est une fête « déterministe » qui engage les enfants Kabyles et leurs parents à donner le meilleur d’eux-mêmes.
A la fin Yennayer, les enfants étaient envoyés par leur mère chanter par trois fois à l’oreille droite des boeufs de la maison en tapant dans une casserole : « Janvier s’en est allé ô boeuf ! » (Yennayer iffe$ ay azger !). Voici un extrait d’une chanson dédié à Yennayer par les femmes kabyles pour se concilier les bonnes grâces du « souverain des mois ».
LA CHANSON DE YENNAYER
Ô YENNAYER ! ô YENNAYER ! Tu es le maître des champs de blé Ô YENNAYER, ô YENNAYER ! C’est à cause de toi que nous nous bousculons !
Ô YENNAYER, ô YENNAYER ! Mon frère, laisse place à Février Ô YENNAYER, ô YENNAYER ! Ne sois pas dur avec les vieux.
Ô YENNAYER aux bonnes récoltes Tes eaux sont si froides Le pays de mes ancêtres A de tout temps aimé les braves.
Ô YENNAYER comme tu es beau Toi dont le nom est si réputé Les enfants et les femmes t’aiment La montagne te voit comme porteur de bonheur !
Ô YENNAYER ! Ô YENNAYER ! Tu es le meilleur des mois Ô YENNAYER ! Ô YENNAYER ! Sois clément et épargne les exilés.
Toi YENNAYER, paix et lumière Le pays s’appuie sur les traditions Celui qui cherche finit par trouver Là où il y va, Dieu s’y trouve aussi ! CCNA N YENNAYER A Yennayer ! a Yennayer ! Keççini d bab g-iger A Yennayer, a Yennayer Fell-ak i neôwa amdegger.
A Yennayer, a Yennayer Eoo amkan a gma i Fuôaô A Yennayer, a yennayer Taggwadev Öebbi g-gwem$aô
A Yennayer bu ssaba Aman-ik d-isemmaven Tamurt n jeddi d baba I-P ireffden d-irgazen
A Yennayer bu tecrurin A-win mi yezdi yissem Hemmlen-k warrac p-plawin Mi-k yes1a wedrar d ôôsem
A Yennayer, a Yennayer A lexyaô deg-gwagguren A Yennayer, a yennayer Ëader widak yunagen.
A Yennayer lehna tafat Tamurt tedda s tisula Wi nnudan f-kra yufa-t Anda yedda Öebbi yella !
Voici quelques paroles de ma mère à propos de Yennayer : “Sans Yennayer, le bonheur demeure incomplet, car c’est lui qui permet à toute l’année d’avoir son équilibre. Que peut une terre qui n’a pas de reserve d’eau : elle est appelée à souffrir de soif et de sècheresse avant de mourir et de voir mourir les siens”. L’eau c’est la vie. C’est pour cela que le Souverain Suprême a créé la première femme d’une perle de rosée. C’est pour ça que nos ancêtres disaient : “la rosée, c’est la sueur de Yennayer”.” (mebla yennayer, wlac lehcaca di ddunnit ; imi d neppa id yeppaken i wseggwas arkad-is. D-acu i-wi yezmer waka ma yella ur yesƒÕI lufeô d lxezna g-waman : ipeddu ar lmerta n ffad d-uêavum d-u$urar weqbel ad yemmet wad iwali amek pemmaten yidma-s. Aman p-pudert. Af-faya id-yejna Ugellid Ameqqwran tameîîut tamezwarut si tiqit n nnda. Af-faya iqqaren Imezwura nne$ : nnda p-pidi n Yennayer.)
Par Youcef Allioui
Source : http://www.cbf.fr/article.php3?id_article=922
| |
|
|
|
|
|
|
|
Yennayer Ameggaz 2958
12/01/2008 03:03
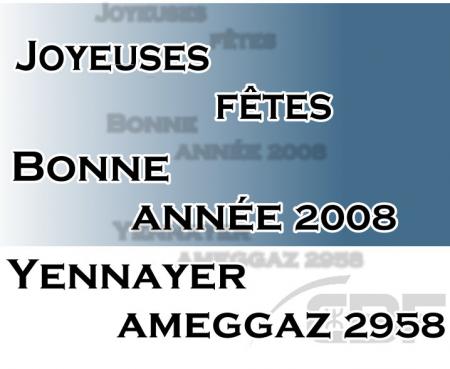
Azul Fell-akent , Azul Fell-awen , 
Saramegh-awen asegwas ameggaz i kwenwi d twaculin-nnwen, d widak akw i th’emlem.
Je vous souhaite une bonne année à vous, à vos familles et à tous ceux que vous aimez.
Arezki Ait-Ouahioune 
Photo du haut source : http://www.cbf.fr/
|
Commentaire de Racid Atali Uqasi (12/01/2008 17:59) :
Azul agma,
Si tama inu saramegh-ak aseggwas amegaz 2958, d win akid yawin talwit,
tazmert d wayen isarem wul-ik.
bmassil@yahoo.ca |
|
Commentaire de Nacira (12/01/2008 18:02) :
Thanemirthik assegwess ameguez oula dkechini lek twachoultik.
lounasnacira@yahoo.ca |
|
Commentaire de ninafodal (12/01/2008 18:44) :
ilmend i n usegas ameynut dass amezwaru n yennayer saramghawen talwit
teghzi n la3mar a
tawdham yakw ayene tessaramem assegwas ameggaz.bonne année et plein de
bonnes choses pour toi et ta petite famille
ninafodal_69@hotmail.com |
|
Commentaire de said (12/01/2008 18:55) :
Bonjour, Salam,
Asougas d ambarch s tinammirine d el hana à tous!!
Heureuse année baraka et paix
sbouhari@yahoo.com |
|
Commentaire de bélaid (13/01/2008 15:55) :
AZUL FELAWEN
ILMEND U SEGWAS AMAYNUTH ESARAMEGHE IMKUL YIWETH, IMKUL YIWEN LEHNA,
THAZMERTH, THEGHZI LAAMAR;
U SARAMEGH AFUD ILHAN ITHDUKLIWIN IMAZIGHEN ANDDA MALANTE
YENNAYER AMEGGAZ
BONNE ANNÉE
SEGUL BELAID SI PARIS.
belaid_4@hotmail.com |
|
Commentaire de krimo (13/01/2008 15:57) :
merci arezki, assegwas ameggaz a toi egalement et a toute ta famille
(petite et grande). que de la joie et de la bonne santé inchallah. di
lehnak.
okrimo15@yahoo.fr |
|
Commentaire de Boudjema (13/01/2008 16:03) :
Azul fellawan ,a l'occasion de yennayer je vous présente mes
meilleurs voeux ,bonne et heureuse année 2958 ... bonne fête à toutes et à
tous.
Boudjema de kouba (Alger)
boudj_ao@yahoo.fr |
|
Commentaire de hinane (13/01/2008 18:41) :
bonjour ,
assegwas ammegaz à toi aussi ,que tn année soit pleine de bonheur et de
joie ,
prends soin de toi et de ta famille ,
ar tufath.
hinane_1206@hotmail.com |
|
Commentaire de farid (13/01/2008 18:42) :
a toi aussi et ta famille merci d´avoir ponnsser arezki c vrement gentille
de ta part
aitelem55@hotmail.com |
|
Commentaire de salim (13/01/2008 22:37) :
BONJOUR, AZUL,
Bonne fête et chaque année en bonne santé,
même moi je te change les mêmes et les meilleures voeux et :
Je te souhaite une bonne année à toi, à ta famille et à tous ceux que tu
aimes, et tous qui sont avec toi dans le travail et les voisins .....
merci Rezki bon courage que Dieu nous protèges
Que notre joie demeure !
ze_milas@yahoo.fr |
|
Commentaire de \ (15/01/2008 01:18) :
Azul
Bonne année berbère à toi et aux tiens.
Ali
poce2003@yahoo.fr |
|
Commentaire de cheaz amazigh (15/01/2008 02:04) :
azul fell ak
tanemirt tamuqrant gheff ayen id iduridh dayen icebhen dayen kan.
ulla dnek ad akkinigh asseggas ameggaz ikecc t wacultik di mazighen anda
malan.
talwit.
ar tayed.
ilefnumide@hotmail.com |
|
Commentaire de Ali de Jijel. (15/01/2008 04:16) :
Bonjour,
Merci pour les voeux de bonne année. A mon tour de vous souhaiter mes
meilleurs voeux de santé et de bonheur à toi et à toute la famille.
Ali de Jijel.
thanina06@gmail.com |
|
Commentaire de hamid (15/01/2008 04:19) :
AZUL AYARZKI.C'EST AVEC UN GRAND PLAISIR QUE J'AI LU TON MESSAGE
.A MOI AUSSI DE TE SOUHAITER UN JOYEUX YENAYER ,APAREMMENT IL A BAUCOUP DE
SAVEUR AU CANADA MIEUX QU'AU BLED ET BONNE ANNEE 2958.
MES MEILLEURS
VOEUX A TOI ET TA FAMILLE.
hamidyahia_7@yahoo.fr |
|
Commentaire de faycel et sa famille (15/01/2008 04:36) :
Aseggas ameggaz i kwenwi daghent ,bonne année a toute la famille.
f_slimani@yahoo.fr |
|
Commentaire de Mamou (15/01/2008 04:37) :
Assegwas ameggaz i keçç akw at wacultik.
Tazmart, talwit, teghzi la3mar akw dikufa gadrimen.
Un bisou pour Ania.
mamunas15@yahoo.fr |
|
Commentaire de Fatiha (17/01/2008 04:09) :
Merci et à toi de même Arezki !
Santé prospérité et sérénité à toi et les tiens en cette nouvelle année.
fathalouane@aol.com |
|
Commentaire de ryan (17/01/2008 04:11) :
Azul
Bonne année berbère à toi et aux tiens.
Ali
poce2003@yahoo.fr |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Statistiques détaillées du blog Kabylie mon amour( fin déc 2007/début jan 2008).
11/01/2008 23:55
|
Commentaire de Arezki Ait-Ouahioune (12/01/2008 04:47) :
Merci pour vos visites et vos commentaires sur mon blog...
Si j'ai raison c'est grâce à Dieu, si j'ai tort je Le prie
de me Pardonner...
http://kabylie.vip-blog.com
a111@sympatico.ca |
| |
|
|
|
|
|
|
|
L'Algérie profonde ...Tizi-Ouzou : Yennayer ou la fête de la fécondité .
11/01/2008 04:39

Photo : prise par Arezki Ait-Ouahioune (Village de Tassaft Ouguemoune en Kabylie)
La fête de Yennayer, premier jour de l’an amazigh, revêt un moment particulier en Kabylie.Elle reste l’une des fêtes ancestrales qui résiste aux méandres du temps et au changement du mode de vie.
Jour du nouvel an chez les Berbères, elle est aussi la fête de la fécondité et du renouveau. En ce mois, certains paysans plantent toutes sortes d’arbres fruitiers, notamment des oliviers.
Pour d’autres, ils profitent de l’occasion pour se retrouver en famille ou entre amis et passer une soirée conviviale.
À Iferhounène, et comme un peu partout dans la wilaya, cette fête donne lieu à des réjouissances communes. Chacun selon les moyens dont il dispose. Certains font la fête avec plus de modernisme et l’engouement que suscite le nouvel an 2008 est encore là pour célébrer Yennayer : les jeux de lumière et les décors de circonstance animent encore quelques espaces ! Certains commandent même des bûches et se préparent à une soirée de réveillon autour d’un couscous au poulet, comme le veut la tradition. “on doit actualiser cette fête et l’adapter à notre époque”, nous diront des jeunes de la région.
Des repères qu’ils tiennent à garder, car, selon eux, “le mode de vie actuel nous éloignent un peu de nos repères culturels, c’est pourquoi l’on doit joindre les deux bouts”. Pour d’autres : “On aimerait bien que cette fête se généralise, c’est un patrimoine culturel.”
Pour beaucoup, c’est un fait social, une pratique ancestrale et une fête qu’on doit pouvoir sauvegarder, comme autrefois, comme souvenir du passé et un trait d’une identité à actualiser. “C’est bien de retourner aux sources et de retrouver certaines traditions qui commencent à disparaître, comme la fête d’Anzar, le dieu de la pluie dans la mythologie berbère, et bien d’autres pratiques qui témoignent de notre histoire”, comme nous le dira Mohand, un quinquagénaire.
Yennayer est aussi un moment de liesse où l’on honore les nouveaux-nés. Selon certaines traditions, à cette occasion, “on coupait un bout des cheveux du garçon, dont c’est la première coiffe, on mettait celle-ci dans du miel, puis on la conservait dans une tuile”, témoigne une vieille dame, na Tassadit. Une pratique qui, selon elle, éloigne l’enfant du mauvais sort et des maladies.
À l’occasion de cette journée, on invite les proches pour un repas convivial, on leur sert du thé, des gâteaux et du couscous au poulet. “À midi, on sert des beignets et des plats traditionnels, des plats qui s’accompagnent de pain maison, “aghroum”, et puis du café. C’est le soir que le couscous au poulet est servi, “imensi n’Yennayer”, tout cela sur fond de réjouissance et de convivialité”, nous raconte-t-elle.
Des réjouissances qui incluent aussi une forme de partage et de solidarité profitant à tous.
Une fête de nouvel an avec toute son originalité que perpétue la tradition orale et dont la femme kabyle a su préserver la mémoire et le geste, lui donnant une dimension culturelle.
C’est pourquoi ces journées restent aussi un hommage à toutes ces femmes “paysanes”, oubliées de nos temps, qui ont su faire germer le blé et tisser le burnous. Quelquefois, la fête s’accompagne de chute de neige qui plonge la région dans un vrai climat hivernal.
Espérons que ça va être le cas après-demain, 1er jour de l’an berbère.
Aussi, à tous, assegwass ameggaz… 2958.
Par : KOUCEILA TIGHILT
Source : http://www.liberte-algerie.com/edit.php?id=88625&titre=Yennayer%20ou%20la%20fête%20de%20la%20fécondité
| |
|
|
|
|
|
|
|
Yennayer : Que notre joie demeure !
11/01/2008 03:52

De toutes les fêtes berbères, Yennayer est sans doute la plus répandue : on la retrouve non seulement dans les régions berbérophones mais aussi arabophones où diverses traditions sont encore vivantes.
Il est certaine que ces mêmes traditions ne sont plus ce qu’elles étaient, il y a encore un siècle, ainsi que les écrits des ethnologues européens peuvent en témoigner (le carnaval de Yennayer n’est plus qu’un souvenir) mais des bribes des anciens rituels sont gardés, notamment le fameux souper de Yennayer. Contamination des rites saisonniers et des rituels religieux, on va dans les cimetières, et, en Kabylie, on organise une ouaâda (timechret), sacrifices de bœufs et repas communiels. Il y a encore les marchés en fêtes qui, à l’approche du 12 janvier, s’ornent de guirlandes et de friandises.
Les uns disent ‘’rass ‘amm lae’reb’’, c'est-à-dire ‘’jour de l’an arabe (sans doute par opposition au jour de l’an grégorien), les lettrés, eux, disent, ‘’rass el aam el ‘adjami’’, ‘’l’année étrangère (c'est-à-dire non arabe), depuis quelques années, notamment en Algérie, on dit ‘’assegwas n Imazighène’’, ‘’le jour de l’an amazigh ou berbère, berbère étant compris non pas nécessairement par l’usage de la langue berbère, mais maghrébin, autochtone. Qu’en est-il au juste de cette fête que certains, à juste titre, voudraient voir légalisée, parmi les autres fêtes algérienne ?
Un calendrier millénaire
On a beaucoup discuté sur l’origine du calendrier berbère. S’il est effectivement aujourd’hui utilisé dans l’aire géographique berbère, il remonte à l’antiquité méditerranéenne. C’est l’empereur romain Jules Cesar (d’où l’appellation de calendrier julien pour ce calendrier) qui va lui donner, en 45 avant J.C, sa forme définitive.
On sait que les Romains ont d’abord utilisé un calendrier lunaire de 304 jours, répartis en dix mois de 30 ou 31 jours. Or ce calendrier étant solaire, on ne retrouvait plus le rythme des saisons, chaque mois passant pour toutes les saisons. Une première réforme va allonger l’année de 51 jours, la répartissant en 12 mois de 28, 29, 30 ou 31 jours auxquels on a ajouté plus tard un treizième mois intercalaire de 22 ou 23 jours, mais l’année reste toujours courte et on se met à célébrer les fêtes de printemps en automne et celles de l’automne en hiver.
C’est alors que Jules César entreprend sa réforme. Il opte pour un calendrier solaire et divise l’année en 365 jours un quart, quart que l’on compense en ajoutant tous les quatre ans, un jour supplémentaire. Le septième mois prend le nom de César, julius, en français juillet. Pour rattraper le retard enregistré, on ajoute 85 jours à l’année 46 avant JC. En 7 avant JC, on réajuste de nouveau le calendrier : le huitième mois, sextilis, est baptisé augustus, août, en l’honneur d’Auguste, et devient un mois de 31 jours. En même temps, le début de l’année est ramené du 1er mars au 1er janvier.
Mais l’écart reste important. En 326, quand le concile de Nicée l’adopte et l’impose au monde chrétien, l’écart atteint quatre jours. On essaye à rattraper le retard le calendrier continue à dériver si bien qu’à la veille de la réforme grégorienne, il accuse un retard de dix jours sur le temps réel. Le pape Grégoire XIII (1572-1585), met au point la réforme. Il donne à l’année une durée de 365 jours 5 heures 49 minutes et 12 secondes, avec un jour supplémentaire, placé en février, tous les quatre ans. Pour effacer les 10 jours d’écart du calendrier julien, on passe, le jeudi 4 octobre 1582 au vendredi 15 octobre. L’Angleterre, opposée à la papauté, n’adopte la réforme grégorienne qu’en 1751. En Angleterre, le lendemain du 2 septembre 1752 est le 14 et non le 13, car le calendrier julien a perdu entre-temps un autre jour. En Russie, il faut attendre la Révolution d’Octobre pour que la réforme soit appliquée : ce qui fait que la Révolution est fêtée en novembre !
Au Maghreb, le calendrier romain a été abandonné après l’islamisation. Mais il est resté dans les campagnes, imposé par des nécessités techniques : en effet, le calendrier lunaire proposé par l’Islam, ne convient pas au rythme des saisons qui préside aux travaux agricoles. Cependant, il ne connaîtra par les réformes qui l’ont touché au cours des siècles, notamment la réforme grégorienne. C’est la raison pour laquelle, il accuse un retard de douze jours sur le calendrier grégorien. En réalité, le retard de 10 jours du 16ème siècle s’est encore creusé et c’est 14 jours qu’il faut désormais compter !
Les mois du calendrier berbère
La division en douze mois du calendrier berbère nous vient des Romains, ainsi que les dénominations des mois, qu’on peut aisément rapporter à leurs équivalents latins. On les retrouve dans tous les dialectes berbères et même en arabe dialectal. Il est vrai aussi qu’on le retrouve en Egypte, notamment chez les populations Coptes, au pays des pharaons, il date aussi de l’époque romaine. D’ailleurs certains auteurs pensent que ces noms, en arabe comme en berbère, ont été introduits par les conquérants musulmans et ne datent pas de l’époque romaine. En réalité, les noms sont répandus dans tous les dialectes berbères, y compris ceux qui, comme les Touaregs, ont échappé, pendant longtemps à l’influence arabe.
1- Janvier
Latin : januaris mens, mois de Janus ; Berbère : Yennayer, nnayer , Arabe : Yennayer, Yennayer.
2 – Février
Latin : Februarius mens, " mois de la purification ", Berbère : Furar, Arabe : Frâyer.
3 – Mars
Latin : Mars, mois du dieu Mars ; Berbère : Meghres, Arabe : Mars.
4 – Avril
Latin : Aprilis mens ; Berbère : (Ye)brir , Arabe : Abril
5 – Mai
Latin : Maiius, mois de la déesse Maïa ; Berbère : Mayyu, Maggu ; Arabe : Mâyûh
6 – Juin
Latin : Junius, mois de Junon ; Berbère : Yunyu, Yulyu ; Arabe : Yûnyûh.
7 – Juillet
Latin : Julius, mois de Jules César ; Berbère : Yulyu(z) (K) ;Arabe :Yûlyûh
8 – Août
Latin : Augustus, mois d’Auguste ; Berbère : $uct; Arabe : $ûct
9 – Septembre
Latin : September, de Septem " sept " parce que septième mois de l’année julienne qui, alors , commençait en mars ; Berbère : Ctember ; Arabe : Ctenber.
10 – Octobre
Latin : october, de octo : " huit " parce que huitième mois du calendrier julien.
Berbère : tuber, ktuber; Arabe: ktuber,aktuber
11 – Novembre
Latin : november, de novem " neuf "; Berbère : nwamber, wamber;Arabe : nunenber.
12 – Décembre
Latin : december, de decem " dix " ; Berbère : djember, dudjember ; Arabe :djenber
Calendrier et ère berbère
Le calendrier berbère, qui est un calendrier agricole, ne connaît pas de millésime : organisé selon le rythme des saisons, il est perpétuel, et il suffit de lui ajouter le retard qu’il cumule sur le calendrier grégorien (officiellement 12 jours mais en réalité 14 jours) pour établir la correspondance avec ce calendrier.. Depuis quelques années, on date ce calendrier, établissant ainsi une ère, dite berbère. Le point de repère choisi est 950 avant J.C, date à laquelle un membre de la tribu berbère des Mashawash qui a envahi l’Egypte, devient, à Bubastis, pharaon, sous le nom de Sheshonq 1er, fondant la première dynastie berbère d’Egypte. On sait que Sheshonq a vaincu les armées égyptiennes et a envahi la Palestine, la a Bible, l’appellant Sesac. Il est rapporté qu’il a écrasé les troupes du roi de Judée Roboam et pillé les trésors du temple de Salomon à Jérusalem. Certains n’hésitent pas à dire que c’est un 1er Yannayer que Sheshonq aurait vaincu Ramses, mais en réalité, on ignore la date exacte de la bataille, et le calendrier julien, élaboré plusieurs siècles plus tard, ne peut dater cet événement. L’année 2008 du calendrier grégorien correspond à l’année 2958. ..
Un symbole de la fertilité
Si la forme et la dénomination des mois calendrier berbère sont d’origine romaine, il n’en est rien des symboles. Aucune des festivités antiques–ides et nonnes latines- ne sont demeurées, en, revanche, toutes les fêtes sont placées sous l’égide des travaux agricoles, première préoccupation des paysans berbères.
Le premier jour de l’année –qui reçoit justement le nom de Yennayer- est appelée, en Kabylie tibbura useggas ou Porte de l’année’’ parce qu’il marque une rupture. On est encore en hiver mais on aperçoit déjà les prémisses du renouveau, puisque le froid devient moins rigoureux et que la terre promet des cultures que l’on voudrait abondantes.
Le rite le plus important et le plus répandu de Yennayer, en Algérie et au Maghreb, est le sacrifice d’animaux, notamment de poulets, que l’on élevait, autrefois, dans les campagnes spécialement, . Par les sacrifices sanglants on cherche à fructifier la terre. Dans toute l’Algérie, le principe de la fête est de faire des repas copieux pour augurer d’une année d’abondance. Le repas principal, préparé la veille de l’incidence, est le souper, préparé la veille de l’incidence : c’est l’imensi n innayer, appelé le ‘aach nnayer chez les arabophones.
Le souper de Yannayer diffère d’une région à une autre. En Kabylie, c’est le couscous ou le berkukes (couscous à gros grains), en Oranie, c’est le rougag, feuille de pâte fine cuite dans une sauce rouge, accompagnée de légumes et de pois-chiches et le cherchem, mélange de légumes secs, notamment les fèves et les pois-chiches, bouillis avec du blé, égouttés et servis chauds. On privilégie les nourritures symbolisant la fécondité, comme les crêpes, les beignets ou les plats de fèves. A contrario, on évite les aliments épicés ou amers car ils sont de mauvais présages pour l’année.
Le jour de la fête, on sert des fruits frais et surtout des fruits secs, symboles de douceur et de vie heureuse, tels les cacahuètes, les amandes, les noix, les noisettes, les dattes, les figues sèches : c’est le mkhalat des gens de l’Est et de l’Ouest, le triez des Algérois. On a beaucoup polémiqué sur l’origine de ce mot, le renvoyant, notamment, au français treize, à cause des éléments qui composent le mélange. En réalité le mot vient du berbère, adriz, qui signifie ‘’fête’’. Ces plats sont servis avec du poulet, on égorge aussi des dindes, parfois des moutons ou des chèvres. On pense que le sang versé appelle la protection des forces invisibles. Le principe est de manger à satiété, de ne rien laisser dans son plat pour que l’année soit placée sous de bons auspices. Autrefois même, on préconisait de manger un poulet par personne. Ce qui n’est pas aujourd’hui très économique !
Fête du renouvellement
Yennayer est également un symbole du renouvellement. L’un des principes de la fête, pour changer de cycle, est de changer certaines habitudes. Dans les villages, on refaisait le foyer creusé dans le sol, on repasse la maison à la chaux, on change les trois pierres du foyer. Ce rite appelé Bu-ini dans les Aurès a fait croire qu’il s’agit de la déformation de l’expression latine bonus anus , " bonne année ". En fait, l’expression signifie " celui des trois pierres du foyer " ini étant le mot berbère désignant la pierre du foyer. Le mot se retrouve dans certaines régions du Maroc sous la forme Biannu et Bennayo et désigne la nuit du 1er Yennayer. En Kabylie, on se rend dans les bois pour cueillir les premières plantes vertes que l’on accroche sur le linteau des portes et les cornes des bêtes. Certains usages sont proscrits. Ainsi, on ne balaie pas ce jour-là, parce qu’on risque de chasser, avec la poussière, les bonnes influences! Autres festivités de Yannayer. La fête était associée, dans tous les Maghreb aux mascarades. C’était, en Kabylie l’Amragh Uchequf, ‘’le vieux du tesson de poterie’’, que l’on fêtait dans la Vallée de la Soummam. L’amghrar représente l’année écoulée : on le figurait par un vieillard sournois qui va frapper aux maisons et que l’on chasse. Ce carnaval a disparu. Aujourd’hui des bribes du carnaval de Yennayer sont conservées ches les Beni Snous, dans la région de Tlemcen, avec pour personnage central, le lion, appelé ayrad, un des vieux noms du fauve en berbère. La bête, promenée par les adolescents, va de maison en maison, collectant des fruits secs et des beignets. On joue du tambour, on chante, on danse et on crie. Un autre rite de Yennayer était les feux de joie, que l’on allumait la veille de la fête et au-dessus desquels on sautait. On croyait ainsi se débarrasser des mauvaises influences de l’année passée et s’assurer une bonne santé pour l’année à venir.
Renouveau de Yennayer
Yennayer est devenue, depuis quelques années, une fête médiatisée. Les célébrations et les anciens rituels sont de retour : certains y voient l’affirmation d’une identité berbère, d’autre un élément du patrimoine national à valoriser. Beaucoup, en tout cas, demande que la fête soit fériée et qu’elle ait sa place dans le calendrier des fêtes nationales. Bonne année Yenmayer et que notre joie demeure !
Patrimoine
L’identité linguistique de la Kabylie :
Les langues ont toutes commencé par être des dialectes(1)
Toute langue, quelle qu’elle soit, a été un dialecte puisqu’à l’origine du mot grec dialecte –dialektos- il y a l’idée de ‘’conversation’’, de ‘’langage dans lequel on tient une conversation’’ Il n’y a plus que les politiques pour croire aujourd’hui à l’homogénéisation linguistique des sociétés humaines : pour des raisons idéologiques, telle l’unité nationale, autour d’une langue, on a souvent eu tendance à effacer les différences entre les langues, voire même à opprimer des expressions linguistiques, parce que, croyait-on, opposés à l’unité des nations. Ce n’est un secret pour personne que les ‘’grandes langues de civilisation’’ ont toutes été des dialectes, voire ne comportaient même pas d’écriture !
Les langues les plus prestigieuses ont été des dialectes
Ainsi l’anglais est une langue indo-européenne, importé du continent et qui est arrivé à supplanter les langues celtiques (le gallois se défend bien et l’irlandais est toujours vivant, en dépit d’une perte importante de ses locuteurs) : au IX siècle, on parlait au moment de la conquête normande trois dialectes, le saxon occidental au sud, l’anglien et le kentien au sud, le kentien devenant la langue littéraire. La conquête normande va remplacer le saxon occidental par le français mais les dialectes continuent à être utilisés dans les campagnes, mais aussi par la petite noblesse. Ce bilinguisme, français-anglais va durer pratiquement pendant trois siècles, de 1100 à 1400. Ce n’est que vers le 15ième siècle que l’anglais littéraire va prendre de l’importance. Un siècle après, avec la découverte de l’imprimerie, l’anglais se stabilise pour fournir les bases de la langue moderne. Avec l’établissement des Anglais dans les colonies d’Amérique, l’anglais parlé dans ces colonies et en Grande Bretagne est pratiquement le même. C’est ainsi que parti d’un dialecte, le saxon, l’anglais est arrivé à battre les autres dialectes, qui étaient pourtant ses égaux. Le cas du français est encore plus patent. Ici les langues indigènes ont été totalement effacées et il ne reste plus que quelques mots gaulois, éparpillés dans le français actuel. L’histoire du français commence avec la colonisation romaine. Il ne s’agit pas du latin classique mais du latin ‘’vulgaire’’, appelé encore gallo-roman, que l’on suppose avoir été la langue parlée alors dans l’Empire romain d’occident. Avec les invasion germaniques, le gallo-roman s’effrite en plusieurs dialectes que l’on divise en gros en langue d’oïl au nord et en langue d’oïc au sud. L’ancien français s’est formé dans le domaine des langues d’oïl : ses variantes parlées et écrites en Ile-de-France seront utilisées par les roi pour unir le pays. Les autres expressions seront aussitôt combattues : l’école ; obligatoire et gratuite, va les effacer totalement. Aujourd’hui, les patois (c’est le terme par lequel on désigne les langues régionales), quand ils ont encore la chance d’exister, vivent leurs dernières heures. Le cas du breton, langue celtique, postérieure à la présence romaine, est différent : même si la langue a perdu beaucoup de ses locuteurs, elle se montre encore suffisamment vivace pour résister aux assauts du français. Un troisième cas peut être envisagé : celui de l’arabe. Au début de l’ère chrétienne, l’arabe n’était que la langue de quelques tribus arabes, éparpillées dans le désert dont seulement quelques-unes s’étaient fixées dans les oasis. De plus l’arabe n’occupait pas toute la péninsule arabique qui comprenait plusieurs langues apparentées mais distinctes. Le sudarabique était notamment connu –bien avant l’arabe- par les inscriptions datant du 8ème siècle avant J.C. La forme la plus connue de cette langue était le minéen, auxquelles se sont substitué plus tard, sur le territoire même du Yémen, le sabéen, l’awsanique, le qatbanite et le hadramoutique. Ces langues ont été les véhicules de grandes civilisations, notamment le royaume de Saba, ses monuments imposants et son écriture qui, depuis qu’elle a été déchiffrée au 19ème siècle, a livré des bribes de l’histoire yéménite. Quand l’arabe apparaît sous forme d’écriture plusieurs siècles se sont écoulés. Il s’agit de l’inscription dit de Hidjra, dans le nord du Hedjaz, datant de 287 après J.C., et celle d’Imru al Qays, le poète des Arabes, datée de 328 après J.C. Mais l’arabe allait bénéficier d’une chance qui allait le précipiter au premier rang des langues de la Péninsule : l’islam, une religion dynamique, qui va non seulement gagner toute la Péninsule mais la moitié du monde antique. Le sudarabique a disparu sous la pression de l’arabe, langue de la révélation, et ne subsiste plus que dans le Hadramout et l’Oman. L’arabe gagne d’autres domaines, se substituant à d’autres langues de prestiges, comme l’Egyptien, le syriaque-etc. Ses parlers sont aujourd’hui très différents, à cause des brassages qu’il y a eu entre les armées musulmanes et les populations locales, à différentes étapes de la conquête. De plus, les dialectes arabes se sont superposés à d’autres langues, différentes selon les régions : égyptien, syriaque, berbère etc. La politique de valorisation de la langue de la révélation allait reléguer les dialectes arabes au second plan, devenant ainsi des dialectes, au sens le plus péjoratif du terme. C’est ainsi qu’à l’époque moderne, l’arabe classique est devenu la langue officielle des Etats arabes, en dépit du fait que cet arabe n’est nulle part la langue des masses. Finalement, la seule région du domaine arabe à avoir fait de l’arabe dialectale est… l’île de Malte. Il est vrai qu’il ne s’agit pas d’un Etat musulman, et que la langue n’a pas la même place dans le monde arabe.
Toute langue a été un dialecte
C'est-à-dire une pratique orale de la langue, puisque toute langue a d’abord été une forme orale.
La même distinction existe aussi en arabe où l’arabe, lahdja, actuellement ‘’dialectes’’ avait, lui aussi, le sens premier de ‘’langage dans lequel on parle’’, et façih al Lahdja signifie ‘’qui parle facilement et abandonnement’’. C’est à une époque récente qu’on a commencé à établir un lien entre pratiques linguistiques et péjoration. C’est surtout l’association à des groupes populaires ou ethniques qui a restreint l’usage de ces mots à la désignation de pratiques régionales.
Quand on veut déprécier tamazight il n’est pas rare de la traiter de dialecte et on refuse toujours de lui donner la qualité de ‘’langue’’. Or, toute expression linguistique est avant tout une langue, puisque décrire une langue, c’est avant tout décrire les éléments qui participent à l’établissement de la communication. C’est décrire son système phonologique, ses règles de grammaire, son lexique, les procédés par les quels s’établi la communication. Or, toutes langues possèdent ces caractéristiques qui sont les caractéristiques des langues humaines.
Dans le cas de tamazight, le mot ‘’dialecte’’ remet complètement en cause le principe même de langue. Si un dialecte est toujours le dialecte d’une langue (ainsi on parle de dialectes arabes pour l’arabe) il faut obligatoirement envisager une langue amazigh, à moins que l’on considère tamazight comme le dialecte d’une autre langue, en l’occurrence l’arabe, comme le soutiennent encore parfois des " linguistes " et des " historiens " qui continuent à puiser leur information dans le fatras des légendes des auteurs arabes du Moyen Age. Il est heureux qu’aujourd’hui l’Etat algérien ne parle plus dans ses institutions que de langue amazighe et qu’il est prévu de doter prochainement la langue d’une académie qui facilitera l’intégration et le renouveau de la langue.
Ceci, dit, il faut reconnaître que tamazight est fortement émiettée et que la langue, victime d’une répression séculaire, n’a pu s’unifier, mais il n’y a pas de doute que, demain, l’usage régulier de l’écriture, la multiplication des publications, la scolarisation massive, l’introduction de la langue dans l’administration ainsi que la fondation d’une instance de normalisation, favoriseront l’émergence d’une tamazight standard, qui transcendera les dialectes. En attendant, on pourra opter pour un développement séparé, qui prépare chaque dialecte à s’adapter au conditions de la vie moderne, en tentant de s’inspirer des expériences des uns et des autres.
La Kabylie, bastion de la revendication amazighe
C’est en Kabylie où la demande en matière de scolarisation, d’édition et de communication en berbère est la plus forte : l’expérience récente de l’introduction du berbère à l’école a montré que, selon les années, 85 à 92% des apprenants ont été recensés en Kabylie, le nombre des élèves, dans les autres régions n’a cessé de diminuer jusqu’à disparaître de villes comme Batna et Ghardaïa, données pourtant comme des centres importants de la berbérophonie algérienne.
Si la Kabylie est un foyer de revendication culturelle et linguistique, c’est parce qu’elle a pris très tôt conscience de son particularisme linguistique. Le système des écoles françaises, tout en cherchant à assimiler les jeunes Kabyles ont souvent abouti l’effet inverse : la langue française va servir à s’approprier le patrimoine linguistiques et culturel amazigh. Certains de ces écrivains vont composé des ouvrages pour les faire connaître et pour les enseigner (Bensdira, , Boulifa, ….). Les grands écrivains, comme J. et T. Amrouche, M. Feraoun et M. Mammeri, prendront le relais, tout au long du vingtième siècle, produisant une œuvre littéraire en langue française de haute facture où abondent les références à la Kabylie et à la culture berbère . Cet engouement ne devait pas remettre en cause les sentiments nationalistes des populations kabyles qui prendront les armes à plusieurs reprises en Kabylie, notamment lors de la Révolution.
Patrimoine
L’identité linguistique de la Kabylie
L’histoire linguistique de la Kabylie(2)
La diversité linguistique, qui est une réalité de toutes les sociétés humaines, ne remet pas en cause l’unité des Etats qui, elle, est d’essence politique.
Si pendant longtemps, le tamazight a résisté aux invasions étrangères, notamment phénicienne et romaine, il ne cesse, depuis le 7ème siècle de l’ère chrétienne, de reculer devant l’arabe. C’est que l’arabe a été porteur d’un message, l’Islam, auquel les Berbères s’étaient convertis en masses. Langue liturgique d’abord, l’arabe s’est ensuite taillé un domaine au point de devenir, aujourd’hui, la langue dominante au Maghreb.
La langue autochtone, autrefois dominante, n’a cessé de se réduire en peau de chagrin. Elle s’est principalement réfugiée dans les montagnes et dans les déserts, et même là, elle est parfois concurrencée par l’arabe, comme dans le Djebel Nefousa, donnée encore il y a quelques années comme entièrement berbérophones.
En Algérie aussi, certaines montagnes de l’est algérien –comme c’est le cas de Jijel- sont également arabisées, alors qu’au moment de la colonisation française, ces montagnes étaient données comme largement berbérophones. La colonisation française a largement participé à la déstructuration des sociétés berbères, en bouleversant les modes de production locales, en favorisant les déplacements et en brassant les populations. Ainsi, quand E. Doutté et F. Gautier ont réalisé, au début du vingtième siècle, leur enquête sur la dispersion de la langue berbère, des villes comme Blida étaient totalement berbérophone et des villes comme Dellys n’étaient que partiellement arabisées. Aujourd’hui, les berbérophones ne représentent plus en Algérie qu’un tiers de la population en Algérie. Le groupe le plus important est celui de la Kabylie, qui concentre près des trois quarts des berbérophones algériens, en deuxième position viennent celui des Aurès et celui du Mzab. Ce dernier groupe est loin d’avoir l’importance numérique des deux autres groupes, mais il est très homogène, puisque les Mozabites, en plus de leur particularisme linguistique se distinguent des autres par leur particularisme religieux, l’ibadisme, issu du mouvement kharéjites qui a secoué autrefois le monde musulman et se réduit aujourd’hui à quelques communautés. Le touareg, qui occupe un espace important dans le désert, se réduit en fait à un nombre très limité de locuteurs. Quant au reste du berbère algérien, il se réduit en îlot, plus ou moins menacés par l’arabisation. Finalement en dehors d’un nombre précis de locuteurs, de l’homogénéité de la société et surtout d’une prise de conscience de l’identité linguistique, tamazight ne peut qu’accuser des pertes.

La Kabylie, foyer de la revendication berbère
Si la Kabylie est le centre de la revendication amazigh, c’est parce qu’elle a très tôt pris conscience de son particularisme linguistique. Dès la fin du dix-neuvième siècle, des jeunes Kabyles, formés à l’école française, ont commencé à s’intéresser à leur langue et à composer des ouvrages pour la faire connaître et surtout pour montrer leur fierté d’un passé qui les valorise.
Cependant, le mouvement nationaliste algérien -pourtant animé en partie par des Kabyles- va entretenir un amalgame entre le ‘’berbérisme’’ et le colonialisme, accusé de vouloir diviser le peuple algérien. Des militants d’origine kabyle demandent qu’on prenne en compte la dimension berbère dans la définition de la personnalité algérienne. Un rapport, établi par les dirigeants de la Fédération de France du parti du Parti du peuple algérien.
C’est la fameuse ‘’crise berbériste’’ de 1949 : les chefs nationalistes accusent les militants dissidents d’être l’objet d’un complot colonialiste. La guerre de Libération va pousser les dirigeants à atténuer les divergences, unité oblige, et il y aura un sorte de consensus à mettre en veilleuse les problèmes jusqu’à l’indépendance. Cependant, à l’indépendance, les choix seront faits : quand il s’agira de choisir la langue du futur Etat algérien, ce sera la langue arabe classique, définie comme l’un des éléments de la personnalité algérienne. Si l’arabe a été choisi, c’est pour répondre au colonialisme, en lui opposant une langue au passé prestigieux mais surtout une langue unitaire, qui ne connaît pas, parce qu’elle est figée, le foisonnement dialectal de l’arabe parlé ou du berbère.
Contre le monolithisme linguistique
Le premier président de la République algérienne, Ahmed Benbella, donne le ton en lançant la fameuse formules : " Nous sommes Arabes, nous sommes Arabes, nous sommes Arabes "Il ne s’adresse pas seulement aux dirigeants arabes, qui attendaient cet engagement de l’Algérie indépendante, mais aussi à tous les Algériens qui avaient un jour caressé l’idée de construire une identité algérienne tenant compte réellement de toutes les réalités, linguistiques et culturelle du pays, pour lequel de gros sacrifices venaient d’être consentis. Certes on ne nie pas l’appartenance amazighe au pays, mais on pense que la conversion des Berbères à l’islam, les a définitivement inscrit dans l’orbite culturelle des Arabes. Cette conception est aujourd’hui encore formulée par la conception : " Nous sommes Berbères mais l’Islam nous a arabisés ". Les régimes qui vont suivre ne feront aucune place au berbère : la langue berbère est perçue comme un facteur de désunion, et la revendiquer, équivaut à remettre cette union en cause. Des militants seront traduits devant les tribunaux et condamnés à de lourdes peines. Pendant ce temps, des mesures sont prises pour renforcer la langue arabe. C’est le cas de l’ordonnance 68/92 du 26 avril 1968 portant obligation de la connaissance de la langue arabe pour les fonctionnaires et assimilés, ordonnance 73/55 du 1er octobre 1973 portant arabisation des sceaux nationaux, Constitution de 1976 qui consacre l’arabe unique langue nationale et officielle de l’Algérie…
Des militants kabyles se redéploient aux niveau de l’université et surtout dans l’exil où un mouvement d’opposition se dessine. Mais la grande révolution est menée en 1980, quand une interdiction a été formulée à l’écrivain Mouloud Mammeri, de faire une conférence sur la poésie kabyle : manifestation, grèves générales, d’abord à Tizi Ouzou, puis dans le reste de la Kabylie. Pour la première fois, on demande la constitutionnalisation de la langue berbère, son enseignement et l’engagement de l’Etat à assurer sa promotion.
Le gouvernement va assouplir sa position : le tabou qui pesait sur le mot amazigh est levée, le berbère est intégrée dans le patrimoine national.
L’ouverture démocratique de 1988 va accélérer le mouvement de revendication linguistique : des partis politiques ainsi qu’un mouvement culturel berbère (MCB) la prennent officiellement en charge. Un statut politique est clairement réclamé pour le berbère, celui de langue nationale et officielle. Les autorités vont encore faire des concessions, en accordant cette fois-ci deux départements de langue et culture berbères, au sein des universités de Tizi Ouzou (1990) et de Béjaïa (1991), d’abord pour former des magistères et, depuis 1997, des licences. En 1995, à la suite du boycott scolaire, qui a atteint la Kabylie pendant une année, un Haut Commissariat à l’amazighité est crée, avec pour objectif la promotion de la langue amazighe.
Depuis, un enseignement de langue amazighe sera programmé dans quelques wilayas, notamment les wilayas berbérophones. Ici encore la Kabylie se taille la part du lion de cet enseignement. C’est en Kabylie, en effet, où la demande en matière de scolarisation, d’édition et de communication en berbère est la plus forte : l’expérience récente de l’introduction du berbère à l’école a montré que, selon les années, 85 à 92% des apprenants ont été recensés en Kabylie, le nombre des élèves, dans les autres régions n’a cessé de diminuer jusqu’à disparaître de villes comme Batna et Ghardaïa, données pourtant comme des centres importants de la berbérophonie algérienne. Aujourd’hui, l’Etat algérien a montré toute sa disponibilité à promouvoir la langue amazighe, en multipliant les institutions chargées de cette promotion. C’est qu’on a enfin compris que la revendication berbère ne cherche ni à diviser le pays, encore moins à le jeter en pâture à l’ex-puissance coloniale. Le combat des Kabyles pour la reconnaissance de la langue et de la culture berbère, a été, il faut le dire, de tous les combats démocratiques. La diversité linguistique, qui est une réalité de toutes les sociétés humaines, ne remet pas en cause l’unité des Etats qui, elle, est d’essence politique.
Par : S. Aït Laraba
Source :http://www.depechedekabylie.com/read.php?id=50317&ed=MTcwNQ==
| |
|
|
|
|
|
|
|
An Berbère 2958 : Sa célébration prend de l’ampleur chaque année
11/01/2008 03:44
Par : S. K. S.Comme à l’accoutumée et à la veille de chaque Nouvel an berbère qui coïncide avec la date du 12 janvier du calendrier grégorien, tout le peuple algérien désormais et à travers ses 48 départements se prépare activement pour célébrer Yennayer. Seulement, si cette célébration se limitait jadis essentiellement au rituel plat traditionnel, notamment en Kabylie et à tous les foyers, cette année une amélioration dans le programme que ce soit dans l’Oranie ou le Constantinois est envisagé afin de présenter une “explication” la plus caractéristiques possible à cette date-symbole de l’histoire de l’Algérie “imazighen”.
Cette innovation survient en effet en guise d’éclaircissements relatifs aux vieux souvenirs de cette célébration, dans lesquels la tradition revenait à chaque fois comme raison principale de cette considération accordée pourtant avec autant de conviction quant à sa relation étroite vis-à-vis du peuple algérien et de l’Afrique du nord toute entière. Ce sentiment partagé par tous les citoyens se reconnaissant comme tels témoignent et démontrent combien ces derniers sont attachés à leur culture ancestrale. Aussi, à défaut de maîtrise scientifique, la population s’est toujours contentée de l’activité légendaire dont le but est sans doute de préserver les quelques repères restant de l’intrusion d’autres civilisations dévastatrices et déstabilisatrices en même temps. D’ailleurs, pour illustration il ne reste que les femmes et encore d’un certain âge, qui s’adonnent véritablement, à une fête digne de ce nom puisque quelques jours déjà avant le rendez-vous, elles se préparent pour se rendre aux habituels lieux saints réputés comme étant des lieux qui répondent à leurs souhaits de paix dans les cœurs et de jours meilleurs.
Pour conclure, n’oublions pas que si le peuple algérien amazigh est passé à l’an 2958, il n’en est pas de même par contre pour sa langue qui demeure sans statut officiel.
Souhaitons quand même Assegwas amegaz aux Berbères du monde entier.
Source : http://www.depechedekabylie.com/read.php?id=50316&ed=MTcwNQ==
| |
|
|
|
|